C’est une journée en 190 pages, en 10/18.
Réveil difficile, travail forcé. Il fait froid. Il fait froid tout le long du livre. Mais notre protagoniste, Ivan Denissovitch Choukhov, n’est pas dans la pire situation du camp. La pire, c’est ceux qui bossent sur le chantier de la « Cité de la vie socialiste ».
« Là-bas, c’est tout vu, pendant un mois, pas moyen de se chauffer nulle part, pas la moindre cahute. Et il ne faut même pas compter sur un feu – quoi brûler ? Trimer tout ce qu’on sait, voilà la seule planche de salut. » (p.25)
Au GOULAG, boulot-dodo… avec à peine une soupe chaude pour se réchauffer. Les contacts avec l’extérieur sont rarissimes.
Choukhov a reçu des lettres de sa femme… enfin DES lettres, non. Deux pas an. Il a appris dans la dernière, et depuis, ne cesse d’y penser, que les hommes déserte le kolkhoze.
« Ce sont les femmes qui font marcher le kolkhoze, les mêmes qui y sont depuis 1930. » (p.60)
Maintenant, paraît-il que les hommes font des tapis, avec des pochoirs et des vieux draps, et que ça se vend comme des petits pains ! Mais Choukhov, désormais dénué de ses droits, conclut qu’il ne pourra pas entrer dans ce trafic. S’il est au goulag, c’est parce que durant la guerre, il fut prisonnier des allemands. Dans le doute, les russes l’ont accusé d’espionnage à la libération.
Malgré cette ambiance glaciale, les gars ont l’air de bien s’amuser au Goulag ! Y’a même un boute-en-train !
« Kilgas ne sait pas parler sans blaguer. Toute la brigade l’aime bien à cause de cela. […] C’est vrai qu’il se nourrit comme il faut, avec deux colis par mois. Et il a des couleurs, à croire qu’il n’est pas au camp. Pas étonnant qu’il blague. » (p.75)
Pourtant, ça n’a pas l’air facile facile… Il y a plusieurs divisions, un grand nombre. Chacune est dévolue à un chantier on dirait. Les gars de la 82èmepar exemple :
« On les a envoyés creuser des trous. Oh ! des trous pas très grands, 50 cm sur 50 cm et 50 de profondeur ; oui, mais la terre, même l’été, est dure comme de la pierre, alors maintenant qu’elle est prise par le gel, vous pouvez toujours essayer de l’entamer. On tape dessus à la pioche : la pioche glisse ; ça ne donne que des étincelles, mais on n’arrache pas une miette de terre. Et les gars, chacun au bord de son trou, ils regardent tout autour d’eux pour se chauffer ; pas le droit de s’éloigner, alors qu’il n’y a plus qu’à reprendre la pioche ; il n’y a que ça qui réchauffe. » (p.75)
Fait pas chaud dans ce bouquin en effet… ça caille, ça caille… et dans la cahute, ça caille aussi. Je l’ai déjà dit, non ?
« Le charbon commence à faire des braises et donne à présent une chaleur égale. On ne la sent qu’autour du poêle ; dans le reste de la salle, il fait aussi froid qu’avant.
» Ils retirent leurs moufles et, tous les quatre, ils remuent leurs mains au-dessus du poêle.
» Mais les pieds, quand ils sont chaussés, on ne doit jamais les mettre près du feu, faut bien se fourrer ça dans la tête. Si on a des souliers, c’est le cuir qui se fendille ; si on st en bottes de feutre, elles deviennent tout humides, elles fument et on n’a plus chaud. Et si on les met tout près du feu, on les brûle. Alors, il ne reste plus qu’à marcher tout l’hiver, jusqu’au printemps, en bottes trouées ; il n’y a pas à en espérer d’autres. » (p. 85)
D’autres… bottes ! car tout est rationné, pillé, caché… d’ailleurs, contre mauvaise fortune, ça trafique ; les gars grappillent de ci de là, dans la journée, de minuscules morceaux de bois, dans l’espoir d’allumer un feu, le soir, quand ils ne se font pas braquer leur récolte… certains ont des cigarettes. Un dialogue étrange :
« César aussi a quitté ses collègues des bureaux pour rejoindre les siens. Sa pipe jette sur lui des lueurs de braise rouge. Ses moustaches noires sont couvertes de givre. Il demande :
– Alors, capitaine, comment ça va ?
Celui qui est au chaud ne peut pas se mettre dans la peau de celui qui se gèle. En voilà une question en l’air.
– Comment voulez-vous que ça aille ? dit le capitaine en haussant les épaules. J’ai tellement travaillé que j’en ai encore les reins cassés.
Un peu comme pour dire : tu pourrais avoir l’idée de me donner à fumer.
César lui donne à fumer. » (p.134)
Des codes bizarres… avant de rentrer, les gars sont comptés et recomptés. Dans cette journée d’Ivan, apparemment, le compte n’y est pas. Le narrateur rappelle que les compteurs ne savent pas vraiment compter… alors ils s’y reprennent à plusieurs fois. Et ça caille.
Contre de menus services, on peut s’en sortir avec un quignon de pain supplémentaire. C’est ce que compte bien remporter notre héros, Choukhov, en se proposant d’aller chercher pour lui le colis de César, le capitaine et accessoirement, celui qui dort en dessous de sa propre couche, enfin de son châlit. Gagné, César lui laisse sa part…
Ah… le « repas » du soir, tant attendu…
« C’que c’est bon ! C’est pour ce court instant qu’il vit le détenu ! » (p. 165)
« Et Choukhov se met à manger le chou avec ce qui lui reste de bouillon. Il pêche une petite patate, une seule sur les deux gamelles – elle vient de celle de César. Une patate pas bien grosse, gelée bien sûr, dure au milieu et un peu sucrée. Quant au poisson, il n’y en a pour ainsi dire pas, juste une arête sans rien dessus qui surnage de temps à autre. Mais il faut mastiquer la moindre arête et la moindre nageoire, on en suce le jus, c’est bon pour la santé. Tout ça prend du temps, bien sûr ; mais Choukhov n’a plus à se dépêcher. Pour lui, c’est fête aujourd’hui : il a décroché une deuxième portion au déjeuner, une deuxième portion au dîner. Ça vaut bien qu’on laisse tomber tout le reste. » (p. 165)
… et même, comme il va l’apprendre plus tard, César a la chance de recevoir un colis si abondant – gâteaux secs, pain fantaisie, saucisson, beurre et deux kilos de sucre – il en donne quelques miettes à Choukhov : deux gâteaux secs et une rondelle de saucisson. Ce sera alors à son tour de lui être redevable. En fait, c’est chacun son tour.
Entre temps, l’un d’eux est envoyé au trou !
« Quelques voix lui crient, les unes : « courage ! » les autres « Ne te laisse pas aller ! » Que lui dire d’autre ? C’est nous-mêmes qui avons construit la prison, la 104è brigade sait que les murs sont en pierre, le sol en ciment, qu’il n’y a pas la moindre fenêtre, qu’on chauffe le poële juste assez pour que la glace fonde sur les murs et fasse des flaques sur le sol. Pour dormir, des planches nues – dormir, si on ne claque pas trop fort des dents ; trois cents grammes de pain par jour, et de la soupe, rien que le troisième, le sixième et le neuvième jour. » (p. 179)
Quelle rigolade !
Dans le soir, chacun sur son châlit, Choukhov a tout de même une discussion avec son voisin d’étage, Aliochka, un chrétien, raison pour laquelle il se trouve détenu… Aliochka n’est pas si malheureux car « Parmi toutes les choses périssables de cette terre, Dieu nous a instruits à ne demander dans nos prières que notre pain quotidien. « donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien ».
– La ration, c’est-à-dire ? demande Choukhov.
» Mais Aliochka poursuit, ses yeux sont encore plus persuasifs que ses paroles, et il prend la main d’Ivan Denissovitch, la tapote, la caresse :
– Ivan Denissovitch ! il ne faut pas demander dans ses prières un colis ou une portion supplémentaire de soupe. Ce que les hommes placent très haut n’est qu’abjection aux yeux du Seigneur. » (p. 187)
Ce que Choukhov n’aime pas, c’est l’arnaque du Paradis et de l’Enfer, qui, selon lui, n’existent pas. Et finalement, prière ou pas, Aliochka fera son temps, lui dit-il. Ce dernier se révolte : à quoi bon la liberté ? que font les hommes de leur liberté ? Choukhov songe…
« Il ne sait plus bien lui-même s’il désire être libre. Au début, il le voulait très fort et il comptait, chaque soir, combien de jours de son temps étaient passés, et combien il en restait. Mais ensuite, il en a eu assez. » (p. 189)
Parce que, chers lecteurs, si des journées comme ça, vous n’en souhaiteriez à personne, Choukhov, lui « s’endort, pleinement contenté. Il a eu bien de la chance aujourd’hui : on ne l’a pas flanqué au cachot ; on n’a pas collé la brigade à la « Cité socialiste », il s’est organisé une portion de kacha supplémentaire au déjeuner, le chef de brigade s’est bien débrouillé pour le décompte du travail […] Et finalement, il a été le plus fort, il a résisté à la maladie.
Une journée a passé, sur quoi rien n’est venu jeter une ombre, une journée presque heureuse.
De ces journées, durant son temps, de bout en bout, il y en eut trois mille six cent cinquante trois. Les trois en plus, c’est à cause des années bissextiles. »
Conclusion : une bonne journée est une journée durant laquelle on échappe à la maladie, à la prison, son labeur est reconnu et on a mangé à sa faim.
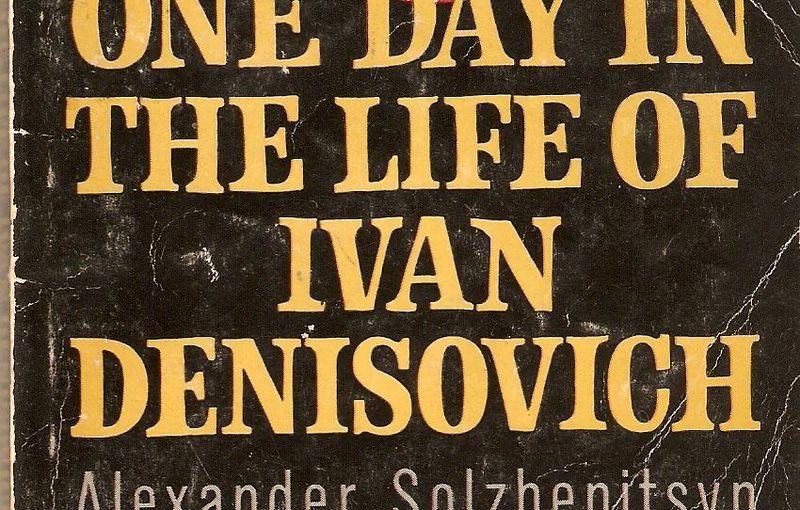
Merci pour ce résumé incroyablement bien fait ! Avec quelques citations qui agrémentent la lecture, c’est parfait et cela m’a permis de lire en un soir ce que j’aurais pris 3 semaines à lire ! ( Je suis en terminale et nous devions avoir terminé la lecture pour demain !) Merci encore !
Bonjour ! Contente de pouvoir t’aider, étant moi-même une enseignante, mais après le bac. Fais attention quand même, mes résumés sont très personnels ; j’essaie de montrer surtout pourquoi les livres m’ont plu et pourquoi je les recommande ! 😉 Bonne chance à toi en tout cas !