L’apport ignoré des sciences cognitives
Un ouvrage comme je les aime ! Avec un objectif clairement exprimé !
« L’objectif de cet ouvrage est d’étudier l’hypothèse selon laquelle les sciences de la nature humaine contemporaines sont susceptibles de nous apporter un éclairage nouveau et complémentaire sur certains objets classiques de la sociologie et de l’anthropologie, sans pour autant nous contraindre à réduire l’explication des phénomènes sociaux ou culturels à un ensemble d’activités neuronales, ni nous conduire à légitimer quelque inégalité sociale que ce soit. » (p. 16)
Alors de quelles sciences de la nature parle-t-on ?
LC note que le naturalisme naît au XIXè. Il en analyse deux types : le naturalisme réductionniste et le naturalisme analogique.
Dans l’approche naturaliste réductionniste : on parle de réductionnisme à double titre, ontologique et épistémologique.La sociobiologie (Wilson) serait l’approche naturaliste réductionniste la plus influente. Pour Wilson « la théorie de l’évolution permettrait d’expliquer la plupart des comportements sociaux des animaux, humains compris. L’idée générale qui sous-tend cette proposition est que la théorie de l’évolution ne s’applique pas uniquement aux propriétés physiques des animaux, mais également à leurs propriétés comportementales. » (p. 23) L’évoféminisme de Peggy Sastre montre ses limites (p. 27) sur l’exemple du harcèlement sexuel.
Dans l’approche naturaliste analogique, certains conservent une forme de réductionnisme épistémologique. Un bel exemple en serait la mémétique de Richard Dawkins (p. 32) « Selon les méméticiens, une culture humaine correspond à un pool de mèmes donné, exactement comme une population d’organismes correspond à un pool génétique donné. » (p. 35) Ses limites : l’analogie sur laquelle elle repose est pour le moins hasardeuse. (p. 37)
Une troisième version du naturalisme pourrait être ce que LC appelle le naturalisme social intégratif. Ce modèle a également ses défenseurs (Schaeffer, 2007) et s’appuie sur le pari « qu’un monisme ontologique peut fort bien s’accompagner d’un pluralisme épistémologique » (p. 41) En d’autres termes : « abandonner les oppositions radicales entre ce qui relèverait de la nature, du social et de la culture n’implique aucunement de devoir renoncer à maintenir des distinctions théoriques et méthodologiques dans l’étude de ces différents domaines. » (p. 41) Les termes de l’ouvrage sont donc reprécisés :
« le naturalisme social qui fait l’objet de cet ouvrage ne vise pas à expliquer les phénomènes sociaux en recourant aux théories ou aux concepts des sciences naturelles, mais à intégrer certaines connaissances et méthodes de ces sciences aux élaborations théoriques et aux démarches explicatives des sociologues. Ce naturalisme social intégratif a ainsi pour vocation de dépasser le clivage qui existe aujourd’hui entre les sciences de la société, d’une part, et les sciences de la nature humaine, de l’autre. » (p. 39)
Voici alors un fort bienvenu plan de l’ouvrage :
« Avant de pouvoir montrer comment des savoirs et des méthodes des sciences cognitives peuvent être avantageusement intégrés aux travaux des anthropologues (chap.4) et des sociologues (chap.5 et 6), il nous faut d’abord nous pencher sur les origines évolutives de notre esprit social (chap.2), puis sur certains aspects centraux de l’architecture cognitive de notre espèce. (chap.3). » (p. 45)
Aux origines de notre cerveau social
Où l’on comprend comment l’étude de nos cousins primates peut se révéler fort instructive, notamment pour souligner comment ont pu être sélectionnés à la fois l’intelligence coopérative et le machiavélisme (p. 59), et de façon concomitante. Les primates non humains qui sont nos contemporains pourraient bien partager avec nous un même cerveau social élémentaire. (p. 85) En effet, « nos plus proches cousins sont le chimpanzé (Pan troglodytes) et le chimpanzé nain (ou bonobos, Pan paniscus) – le dernier ancêtre que nous avons en commun avec eux ayant vécu il y a 5 ou 6 millions d’années seulement. Depuis, notre lignée évolutive s’est séparée de la leur. Homo sapiens s’est spécifié il y a un peu plus de 300 000 ans, en Afrique, à partir d’une lignée d’espèces du genre Homo – un genre apparu il y a environ 2,8 millions d’années. » (p. 86)

De cette continuité, il est possible de déduire plusieurs choses, notamment que la vie en société n’est pas optionnelle : « L’environnement social dans lequel s’est déroulée la phylogenèse de notre espèce a littéralement modelé notre cerveau, nous dotant progressivement de compétences cognitives naturellement adaptées au traitement de l’information sociale pertinente au sein de groupes fortement hiérarchisés et parcourus de réseaux de relations interindividuelles allant de l’antagonisme à la bienveillance, en passant par l’association et l’engagement réciproque. » (p. 88)
La cognition sociale humaine

Où j’apprends que des singes maitrisent un langage ; il s’agit dans l’exemple du singe hocheur (Cercopithecus nictitans) qui par la combinaison de deux cris principaux, se trouvent en mesure d’avertir de l’imminence et de la nature d’un danger, d’un prédateur en particulier. (p. 93)
Comment les humains acquièrent le langage ? Plusieurs modèles ou théories se sont opposées ou renforcées, notamment celles de Chomsky ou de Skinner (p. 96-97). Il en résulte qu’ « un des résultat empirique beaucoup moins controversé au sein de la psychologie cognitive et de la psychologie du développement est que nous possédons dès notre plus jeune âge bon nombre d’intuitions élémentaires quant à la nature et au fonctionnement de certaines entités qui nous entourent. Ces « noyaux de connaissances intuitives » (ou « core knowledge ») sont organisés en « théories naïves » portant sur des domaines spécifiques d’objets. » (p. 104)
Quel est le nombre et la nature de ces théories naïves ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais nous pouvons considérer que notre esprit serait équipé d’au moins trois théories naïves : une physique naïve, dédiée à la détection et au traitement des objets physiques, une biologie naïve, portant sur les êtres vivants, et une psychologie naïve, ou « théorie de l’esprit », ayant pour objet les états mentaux de nos congénères. » À quoi l’on peut ajouter une morale naïve. (p. 107)
De la physique naïve à la sociologie naïve
On note donc que les bébés de quelques mois (3 à 6) ont déjà une physique naïve, une intuition qui leur permet de supposer que les objets continuent d’exister même quand ils ne les voient plus ou bien qu’un objet solide ne peut en traverser un autre. (p. 109)
Les bébés distinguent également dès la première année une différence entre les objets physique et les êtres vivants (p. 111). En outre, « la biologie naïve dont sont équipés les enfants leur permet en outre d’entretenir très tôt des attentes et des intuitions sur la façon dont les êtres vivants fonctionnent et se comportent. » (p. 111)
Remarque (encore plus) intéressante : « Les enfants manifestent en effet certaines intuitions trop tôt dans leur développement pour qu’elles puissent résulter de l’expérience dont ils disposent du monde biologique. Un enfant de 3 ans, par exemple, n’a évidemment jamais eu le loisir de voir un être vivant naître, grandir et vieillir. Cet enfant s’attend néanmoins à ce que les animaux connaissent ce destin. Cela est d’autant plus remarquable qu’il n’entretient pas la même attente à l’égard des objets physiques – les intuitions biologiques des jeunes enfants sont donc d’emblée « domaines spécifiques » (p. 115)
De cette remarque, je m’amuse à extrapoler qu’en effet, les humains anticipent la mort des êtres vivants tandis qu’ils n’anticipent pas vraiment la fin des objets, des ressources environnantes…
Pour ce qui est de la morale naïve et du sens de l’équité, on apprend que les très jeunes enfants (moins de 3 ans) auraient un sens de la justice plus marqué que par la suite… pour le retrouver ensuite vers l’âge de 5 ans. Entre 3 et 5, nous aurions bel et bien à faire à de petits monstres d’égoïsme. (p. 123)
Remarque : selon une expérience, « à l’âge de 5 ans, une partie importante des enfants testés au États-Unis sont prêts à sacrifier des objets qu’ils possèdent pour punir la poupée égoïste, alors qu’ils ne montrent pas la même tendance à l’âge de 3 ans. À noter que si les petits Américains de 5 ans sont disposés à payer pour pouvoir punir les égoïstes, cela ne semble pas être le cas d’enfants du même âge vivant dans des cultures plus collectivistes ». (p. 125)
Je m’interroge ici : n’est-il pas justement primordial de punir les égoïstes dans une société collectiviste ?
« Pour résumer, l’être humain semble donc bel et bien être doté d’une morale naïve biologiquement héritée, qui repose sur des intuitions et des émotions morales plutôt que sur des raisonnements. Ces intuitions et émotions morales sont suscitées par notre disposition naturelle à l’empathie, elle-même réalisée par l’activation de circuits neuronaux spécifiques. Certaines intuitions morales au moins se manifestent déjà au cours de la première année de vie d’un être humain. Il semblerait bien que ces intuitions morales précoces soient universelles et qu’elles continuent à opérer à l’identique à l’âge adulte, quand bien même le sens moral d’un individu se complexifie au cours de son développement. » (p. 128)
Dès l’âge de 4 ou 5 ans, nous serions également dotés d’une « structure cognitive spécifique – appelé théorie de l’esprit ou psychologie naïve – qui nous permet, premièrement, de nous représenter le système de désirs et de croyances qu’entretiennent les autres en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent et, deuxièmement, de comprendre et d’anticiper sur cette base la façon dont ils s’apprêtent à agir. » (p. 131)
« Pour un très grand nombre de psychologues cognitifs, notre théorie de l’esprit constitue l’alpha et l’oméga de la cognition sociale de l’être humain. Ce serait en effet en nous projetant dans l’esprit de nos semblables, en adoptant leur point de vue cognitif sur le monde que nous parviendrions à naviguer avec succès dans notre univers social. Nous serions ainsi en permanence en train de nous représenter les désirs et les croyances des autres individus pour comprendre et anticiper leurs comportements et adapter les nôtres en conséquence. » (p. 134)
Mais que l’on se rassure, selon Hirschfeld (2013), nous sommes assez mauvais dans l’exercice. Nous serions dotés d’une sociologie naïve de groupe plutôt qu’individuelle : « les comportements de nos semblables seraient prédictibles non pas sur la base des états mentaux qu’on leur prête, mais sur la base de certaines de leurs propriétés sociales objectives. » (p. 137)
Quant à la sociologie naïve des relations, on peut en distinguer plusieurs (p. 142) afin de les analyser :
Les relations de dominance
Les relations d’échange
Les relations de soin (« nurturance »)
Les relations d’affiliation (ou d’appartenance).
À la différence des primates non-humains, nous avons une capacité à créer des formes ou entités culturelles (des institutions par exemple) auxquelles nous nous référons conjointement. (p. 155) Elles peuvent engendrer des normes contraignantes. « Il a ainsi été établi qu’à l’âge de 3 ans déjà, les enfants arrivent à découvrir les normes qui sous-tendent une situation particulière en observant simplement les interactions ou le comportement des individus qui y sont impliqués. Qui plus est, les enfants de cet âge sont également capables de recourir aux normes dont ils ont découvert l’existence pour anticiper les actions des autres. Si des individus ne se conforment pas à une norme qu’ils connaissent, les enfants d’âge préscolaire s’en offusquent, s’en indignent et ils les corrigent en leur rappelant la norme en vigueur. » (p. 158)
Je m’interroge : ce respect des règles fonctionne-t-il comme un facteur ou un indicateur d’appartenance au groupe ?
Instincts sociaux et mécanismes affiliatifs naturels
A côté de l’équipement cognitif qui vient d’être décrit, « l’évolution nous a également dotés d’inclinations mentales qui n’ont pas nécessairement pour fonction de nous permettre d’anticiper le comportement de nos semblables, mais qui prennent la forme […] d’ « instincts sociaux ». (p. 160)
Parmi ceux-ci, deux sont analysés par LC : le besoin d’appartenance et la préférence pour la similarité (pp. 161-168), qui pourraient bien se trouver « à l’origine du développement de deux mécanismes affiliatifs naturels auxquels recourent les êtres humains pour tisser et renforcer les liens qui les unissent à leurs semblables : l’imitation et le conformisme. (p. 169)
A propos de l’imitation, on notera que les bébés de 3 mois préfèrent des inconnus du même type ethnique que ceux auxquels ils sont habitués. Plus étonnant et particulièrement intéressant pour la linguistique : « les bébés de moins de 6 mois préfèrent des inconnus qui parlent la même langue que leurs parents par rapport à ceux qui parlent une langue étrangère, tout comme ils préfèrent les inconnus qui ont le même accent que celui de leurs parents par rapport à ceux qui parlent la même langue qu’eux, mais avec un accent étranger. » (p. 167)
L’imitation peut avoir une fonction d’apprentissage et l’on voit que les enfants sélectionnent souvent ce qu’il convient d’imiter pour atteindre un but, mais pas dans tous les cas (p. 172) mais elle permet aussi de créer du lien : « cela s’explique par le fait que les enfants tendent à préférer les individus qui leur ressemblent. Or un enfant qui imite une autre personne augmente manifestement sa ressemblance avec cette dernière. » (p. 177)

Et la « mimiquerie » ? Vous connaissez ? C’est quand on imite les mimiques d’une autre personne, de façon plutôt inconsciente, pour s’en rapprocher et créer ainsi une connivence. Il s’agit encore d’un mécanisme affiliatif auquel les enfants comme les grands recourent volontiers. (p. 179)
Quant au conformisme, révisez d’abord l’expérience de Ash qui montre combien nous sommes enclins à nous conformer au grand nombre, quand bien même le grand nombre fait des choix absurdes. Néanmoins, il semblerait que « la phylogenèse de notre espèce ait équipé notre esprit d’un système de vigilance épistémique, c’est-à-dire d’un ensemble de mécanismes cognitifs qui nous permettent d’évaluer la vraisemblance d’une information, ainsi que la fiabilité de sa source avant de l’intégrer ou de la rejeter. » (p. 181) Nous serions aptes à activer cette vigilance dès l’âge de 3 ou 4 ans…
Pour résumer (LC propose des conclusions fort bienvenues) : notre esprit n’est pas une « cire vierge » ou une « page blanche » : « l’esprit humain est au contraire d’emblée équipé de divers « instincts sociaux », de mécanismes affiliatifs naturels, ainsi que d’un ensemble de modules cognitifs et de noyaux de connaissance intuitives structurés en théories naïves. » (p. 189) De quoi pourrait être responsables ce pré-câblage dans l’apparition et la diffusion de certaines représentations culturelles ?
L’anthropologie cognitive : l’évolutionnisme des premiers anthropologues.
Je sais gré à LC de revenir sur l’erreur qui consiste à croire que Darwin aurait défendu le « droit du plus fort »… et nous l’entendons encore « Je suis darwinien moi m’adame ! c’est celui qui gagne qui gagne ! » Heureusement que c’est faux.
« En effet, la théorie de l’évolution bien comprise nie par définition que les êtres vivants évoluent dans une direction (pré-)déterminée et, donc, que le processus évolutif puisse conduire à l’apparition d’une espèce plus « aboutie » ou plus « parfaite » que les autres. Le mécanisme de sélection naturelle implique qu’au sein d’une espèce, les individus les mieux adaptés à leur environnement du moment (et non les « plus forts ») se reproduisent davantage que leurs congénères comparativement moins bien adaptés. » (p. 193)
Darwin ne valide donc en rien une vision téléologique du monde. Par ailleurs, il faut bien noter le « moment ». Pas de destin, pas d’ère, pas de dessein ou de dessin, mais une vue à très court terme mêlé d’un aléa indescriptible.
La vision téléologique de l’évolution a pourtant eu le temps de faire bien des dégâts. Certains anthropologues étudiant des sociétés « exotiques » pensaient étudier « des sociétés primitives », des cultures « attardées » qui n’avaient pas encore franchi telle ou telle étape du progrès humain. On pourrait dire qu’à leurs yeux elles étaient des « sociétés fossiles ». (p. 198) Cette vision a alimenté les théories raciales et racistes encore visibles aujourd’hui. En lutte contre cela, les anthropologues de la génération suivante défendent le diffusionnisme : « Selon les anthropologues diffusionnistes, un trait culturel qui apparaît dans une société donnée peut en effet fort bien être repris à son compte par un autre groupe humain, sans que ce dernier n’ait préalablement eu à atteindre un quelconque « stade de développement » particulier. » (p. 199) Mais bien entendu, compte tenu de nos difficultés à communiquer et à nous faire exactement comprendre, des déformations et transformations et adaptations entrent en jeu.
LC décrit bien ce que Sperber appelle « une chaîne cognitive causale sociale ». (p. 206)
« En effet, si la communication a pour fonction de causer dans l’esprit du récepteur la formation d’une représentation similaire à celle que possède le communicateur, la nature précise de la représentation communiquée est toujours sous-déterminées par sa traduction communicationnelle. Le récepteur doit dès lors nécessairement chercher à la spécifier par inférence à partir du contexte, ainsi que sur la base de ce qu’il connaît par ailleurs au sujet de ce qui lui est communiqué. Il en découle que la représentation qu’il se formera ne sera jamais parfaitement identique à celle que le communicateur a à l’esprit. Dans certains cas, elle peut même en différer au point d’en devenir méconnaissable. Ce risque est encore amplifié lorsque la chaîne cognitive causale sociale passe par une succession d’individus. » (p. 206) Bref, l’imitation reste partielle comme cela était précisé plus haut (p. 207).
Cependant, pour que ces imitations aient lieu, elles s’appuient peut-être sur une structure commune, organisant nos connaissances intuitives « en théories naïves portant sur des domaines spécifiques d’objets – notamment, sur les domaines des entités physiques, biologiques, psychologiques et sociales. » (p. 218). Nous pouvons retenir de ce passage que « la nature de notre biologie naïve est à l’origine de certaines convergences culturelles – comme le fait que les taxinomies de sens communs possèdent une structure identique dans la plupart des sociétés. » (p. 221) On range et on catégorise à la faveur de et suivant notre biologie naïve, ce qui rend parfois les découvertes scientifiques difficiles à appréhender et à accepter. Ce serait par exemple le cas de la théorie de l’évolution, considérée comme contre-intuitive et, pour cette raison, faisant parfois difficilement concurrence au créationnisme. En effet, pour expliquer le succès surprenant du créationnisme, « l’hypothèse est qu’[il] s’articulerait globalement mieux que la théorie de l’évolution avec notre biologie naïve et, plus particulièrement, avec notre conception spontanément essentialiste des espèces. » (p. 223) or « la théorie scientifique de l’évolution est quant à elle contre-intuitive à plus d’un titre (comme le sont d’ailleurs la plupart des autres théories scientifiques empiriquement bien étayées dont nous disposons aujourd’hui, à commencer par la physique quantique ou la physique de la relativité). » (p. 224) Heureusement, grâce à l’école, nous pouvons en faciliter et institutionnaliser la transmission. (p. 225)
Pour conclure, l’auteur constate qu’ « un certain nombre d’anthropologues contemporains ont pris la mesure de ce que les sciences cognitives sont susceptibles d’apporter à leur discipline. » (p. 239) Qu’en est-il des sociologues ?
Sciences cognitives et théories sociologiques
Deux paradigmes semblent s’opposer : l’individualisme et le holisme méthodologiques.
« Les tenants de l’individualisme méthodologique refusent généralement d’accorder un statut d’existence aux entités collectives et partant, de leur reconnaître un pouvoir causal. Pour eux, seuls les individus et leurs états mentaux existent. » (p. 242)
Parmi eux, Weber explique l’essor du capitalisme par la conversion d’un certain nombre d’individus au calvinisme (p. 243) Pour Boudon, « selon sa « théorie de la rationalité cognitive », les individus pilotent généralement leurs actions sociales en suivant des stratégies réfléchies. » (p. 244) « Boudon soutient que les raisons d’agir des individus ne sont pas uniquement celles qui consistent en la maximisation de leur intérêt personnel. En effet, les individus peuvent aussi notamment intégrer des « raisons axiologiques » (des valeurs) dans le calcul auquel ils s’adonnent pour décider de leurs actions sociales. » (p. 245)
Pour les sociologies holistes-dispositionnalistes, un certain niveau social existe. Pour Durkheim, « chercher à réduire le social à la collection des individus qui le composent équivaudrait à retomber dans les travers « de la vieille métaphysique matérialiste ». Si le substrat de la société est bel et bien constitué d’individus, il émergerait de leur réunion une strate ontologique nouvelle, gouvernée par ses propres lois et peuplée de ses propres objets : la strate de la vie sociale. » (p. 247) Plus tard, Bourdieu « a cherché à préciser la manière dont le monde social exerce son empire sur les individus et sur les représentations qui peuplent leur esprit. Selon lui, le processus de socialisation dote tout individu d’une sorte de matrice de perception, de jugement et d’action qu’il nomme « habitus ». (p. 249)
LC poursuit son analyse et sa revue des théories sociologiques pour défendre l’idée qu’intégrer ce que nous savons désormais de notre « nature » humaine, héritée de notre évolution biologique, ne peut qu’enrichir la sociologie. (p. 256) Il cite notamment le travail de Bronner qui va en ce sens et qui intègre à sa description du monde les fameux biais cognitifs. Ce dernier « en appelle dès lors au développement d’un programme de recherche qui aurait pour objectif d’étudier la façon dont les invariants cognitifs mis au jour par les sciences cognitives « s’hybrident » avec des variables sociales pour donner lieu à la production de certains phénomènes sociaux. » (p. 258)
S’il est vrai que les tenants de l’individualisme méthodologique auraient grand intérêt à s’inspirer des sciences cognitives (p. 258), LC montre que même un modèle holistique comme le concept bourdieusien de l’habitus peut y gagner également. Selon l’hypothèse psychologique bourdieusienne, « des dispositions d’action seraient incorporées par les agents sociaux au cours de leur socialisation. » (p. 265) Or Bronner considère que « l’habitus incorporé est « parfaitement compatible » avec de nombreuses découvertes en neurosciences. Il affirme cependant que les sciences cognitives nous poussent à rejeter une conception strictement déterministe ou mécaniste de l’habitus. En effet, des études de psychologie cognitive ont établi qu’en fonction du contexte dans lequel ils se trouvent, les individus sont en mesure d’inhiber l’expression de certaines heuristiques mentales ou de certaines dispositions pratiques acquises par le passé. » (p. 267)
Pour conclure, même si les deux courants s’opposent, puisque « pour les sociologues dispositionnalistes, les actions individuelles sont à appréhender comme résultant de dispositions incorporées par socialisation, tandis que pour les sociologues individualistes, il s’agit de les comprendre comme si elles étaient le produit de systèmes de raisons élaborées par les individus en fonction de leurs croyances, de leurs désirs et de la configuration sociohistorique dans laquelle ils se trouvent » (p. 280), le recours aux sciences cognitives pourrait permettre d’établir un lien et un continuum « entre la figure théorique de l’agent social des sociologues dispositionnalistes et celle de l’agent social de l’individu rationnel des individualistes méthodologiques. » (p. 281)
Sciences cognitives et explications sociologiques
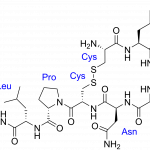
En guise d’exemple de rouage naturels des phénomènes sociaux, LC cite l’ocytocine, un neuropeptide très étudié pour le rôle qu’il joue dans le comportement de nombreux mammifères, les humains notamment. (p. 283) Apparemment, « l’ocytocine amplifie les processus cognitifs de reconnaissance et de discrimination sociale, et elle incite à favoriser son endogroupe aux dépens de son exogroupe. » » (p. 284)
Quels sont les mécanismes qui permettent d’intégrer l’habitus et la reproduction sociale ? Chez les enfants par exemple, comment fonctionne la socialisation ? Il semblerait que le groupe d’amis joue ce rôle de socialisation bien davantage que les parents. Les enfants s’associent à ceux qui leur ressemblent et créent de l’affiliation par imitation et conformisme au groupe d’amis. Par exemple, les enfants adoptent l’accent de leur groupe de pairs (p. 294). La peur d’être ostracisé, néanmoins, joue également un rôle important dans la socialisation. (p. 299) Mais, me dis-je, l’enfant ne rencontre pas les autres enfants telle une cire vierge non plus… pour se reconnaître et se ressembler, il faut être, déjà, quelque chose. Un certain déterminisme familial, en effet, influence de façon non négligeable le devenir des enfants dans leur scolarité : « il est empiriquement établi que le degré d’engagement scolaire des enfants et des adolescents est corrélé à leur milieu social d’origine : ceux d’entre eux qui proviennent de milieux favorisés sont généralement plus engagés – et réussissent donc mieux à l’école – que les enfants ou les adolescents issus de milieux populaires ou défavorisés. » (p. 307) Pour rectifier cela, il suffirait d’intégrer les enfants défavorisés au sein de groupe d’enfants plus favorisés. (p. 307)

« En résumé, les enfants des classes moyennes et supérieures réussissent généralement mieux à l’école et obtiennent souvent de meilleurs diplômes au terme de leur parcours scolaire que les enfants issus des classes populaires. Cela s’explique en partie par le fait que les premiers sont mieux adaptés que les autres aux attentes et aux exigences du système éducatif. Ils font notamment en moyenne preuve d’une attitude implicite plus favorable à l’égard de l’école, ainsi qu’un engagement scolaire plus intense que les enfants de familles modestes. » (p. 311)
Pour conclure, « les sciences cognitives peuvent nous permettre de mieux comprendre la formation de certaines régularités macro-sociales. » (p. 314) et bien sûr les enfants n’arrivent pas vierge de tout déterminisme à l’école : ils « ont probablement entamé leur scolarité dotés d’un bagage de représentations, de comportements et de dispositions relativement similaire. Les enfants intégreront donc, certainement de façon durable un certain nombre de ces attitudes mentales et comportementales, puisqu’elles sont majoritaires au sein de leur groupe de pairs. » (p. 316)
LC répond bien aux objectifs de départ : « Se pencher, comme nous l’avons fait, sur les rouages naturels qui contribuent à la formation de tels phénomènes sociaux ne revient donc aucunement à réduire les seconds aux premiers, et encore moins à chercher à les naturaliser, mais cela permet probablement de mieux en saisir le fonctionnement. » (p. 317)
Pour conclure, j’aime beaucoup l’une des formules finales de LC, pour qui « prétexter de l’existence de […] dérives, aussi graves soient-elles, pour condamner tout recours à certains acquis des sciences naturelles en sociologie reviendrait à jeter le bébé scientifique avec l’eau du bain idéologique. » (p. 320)