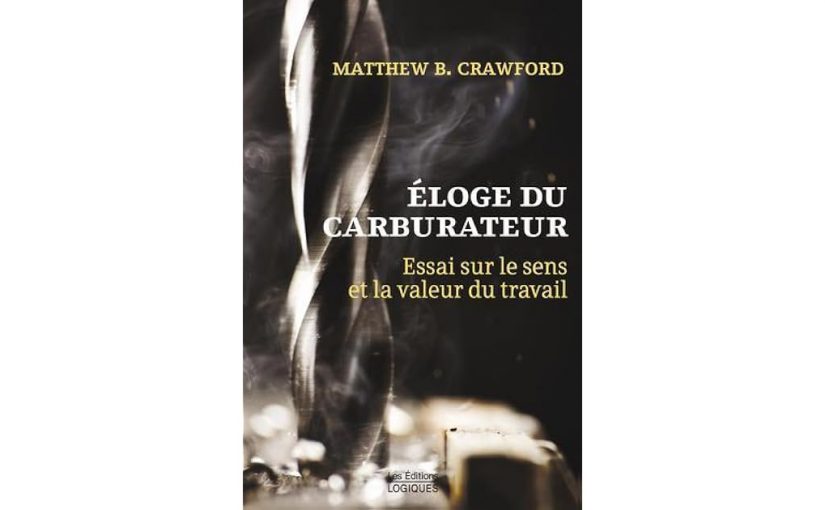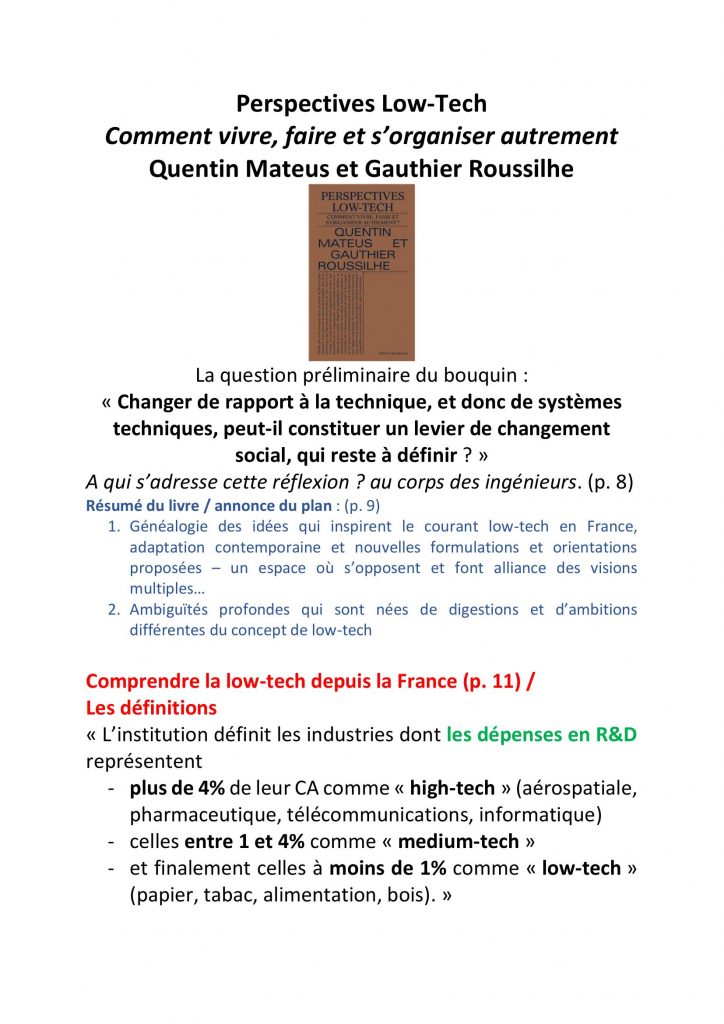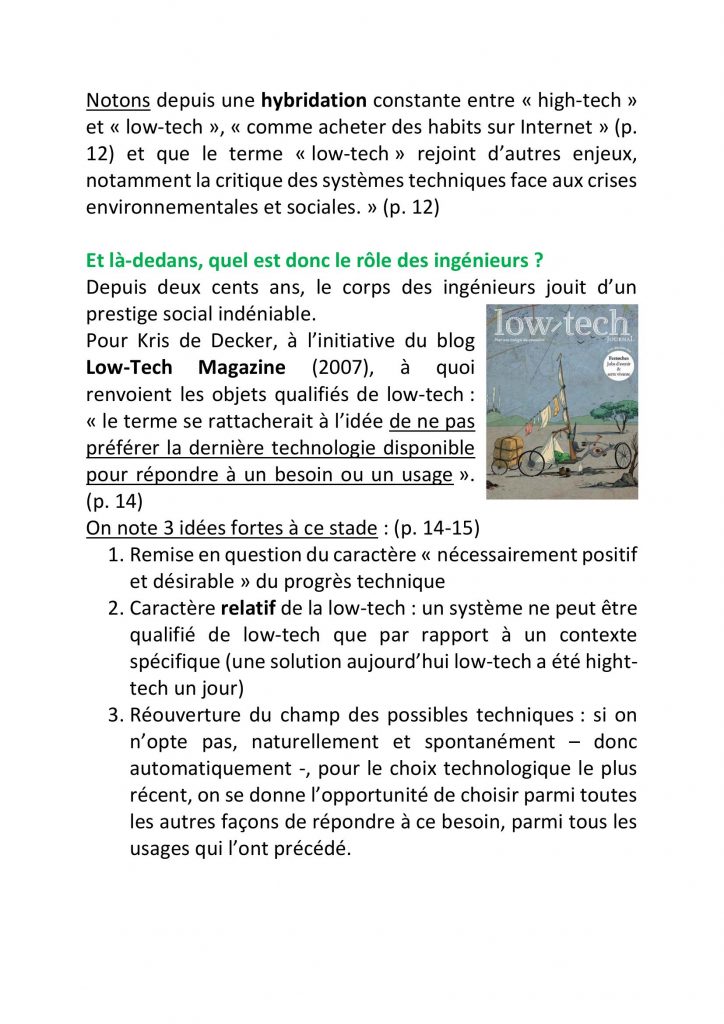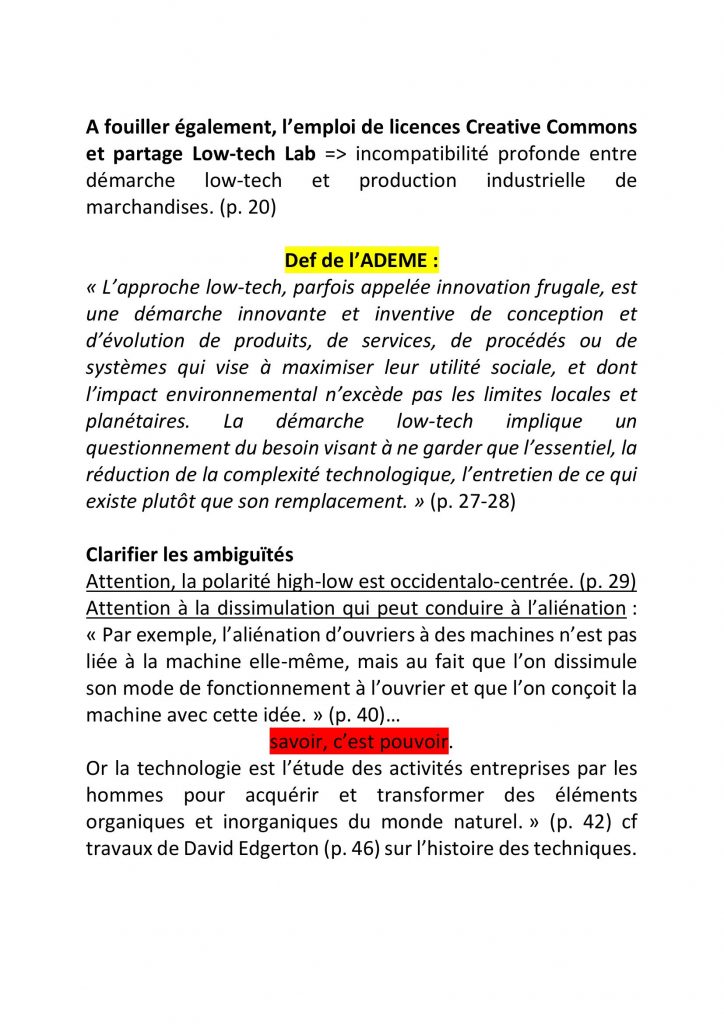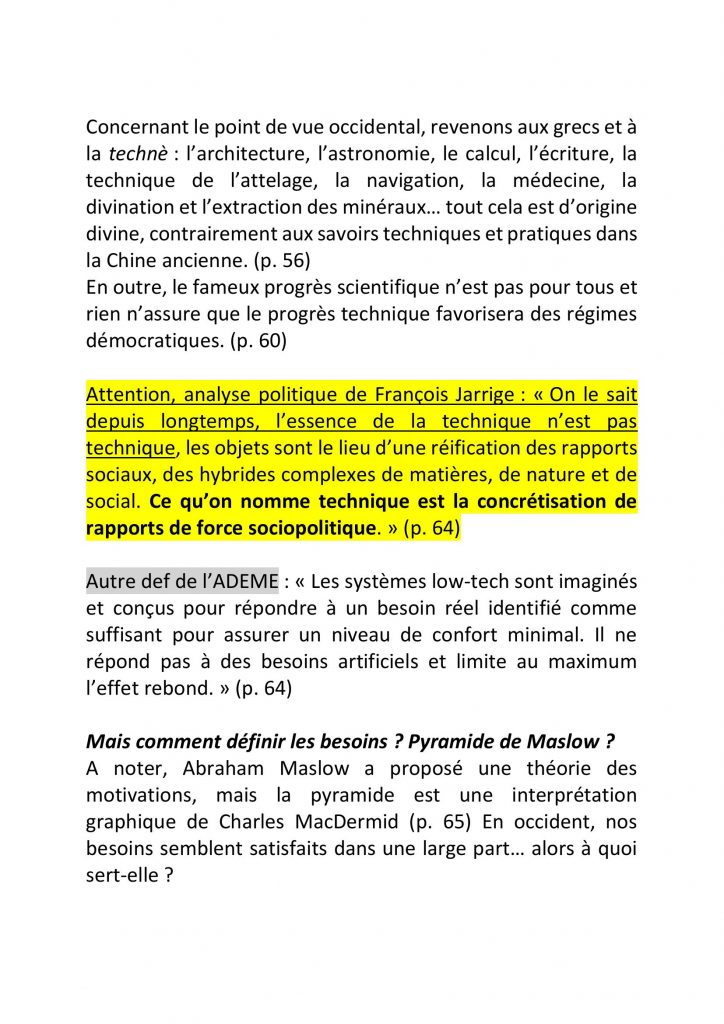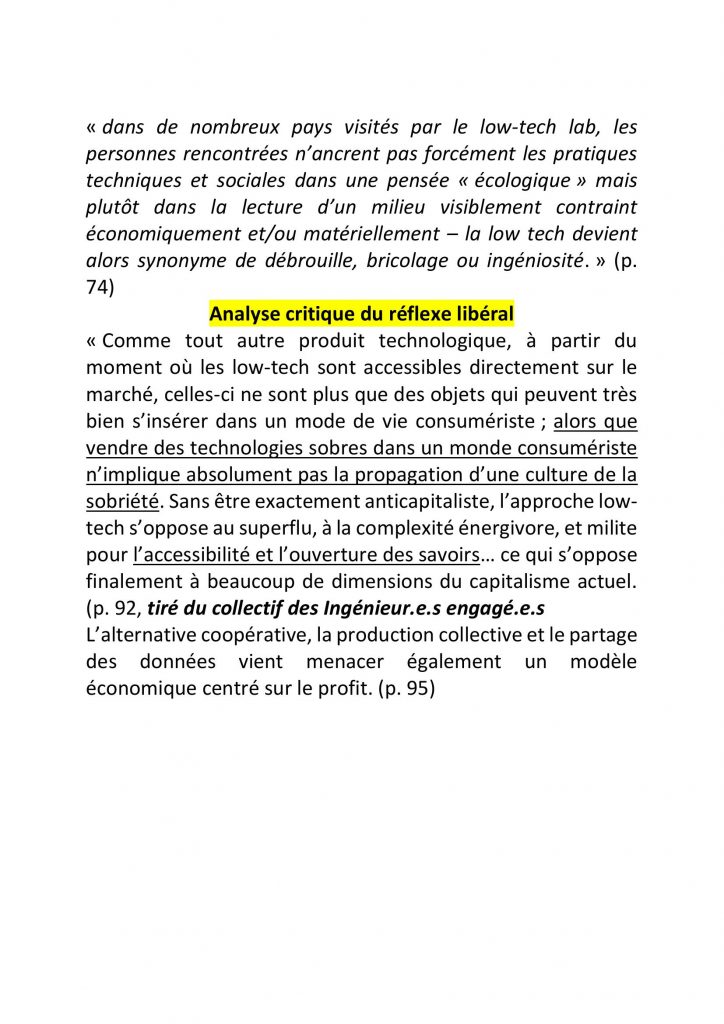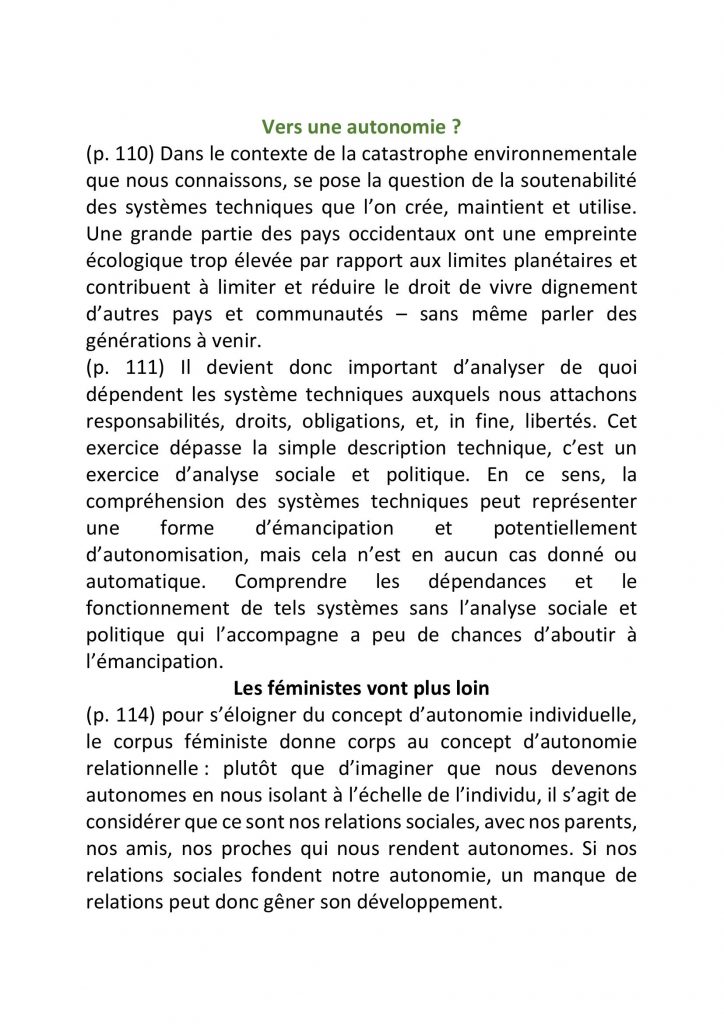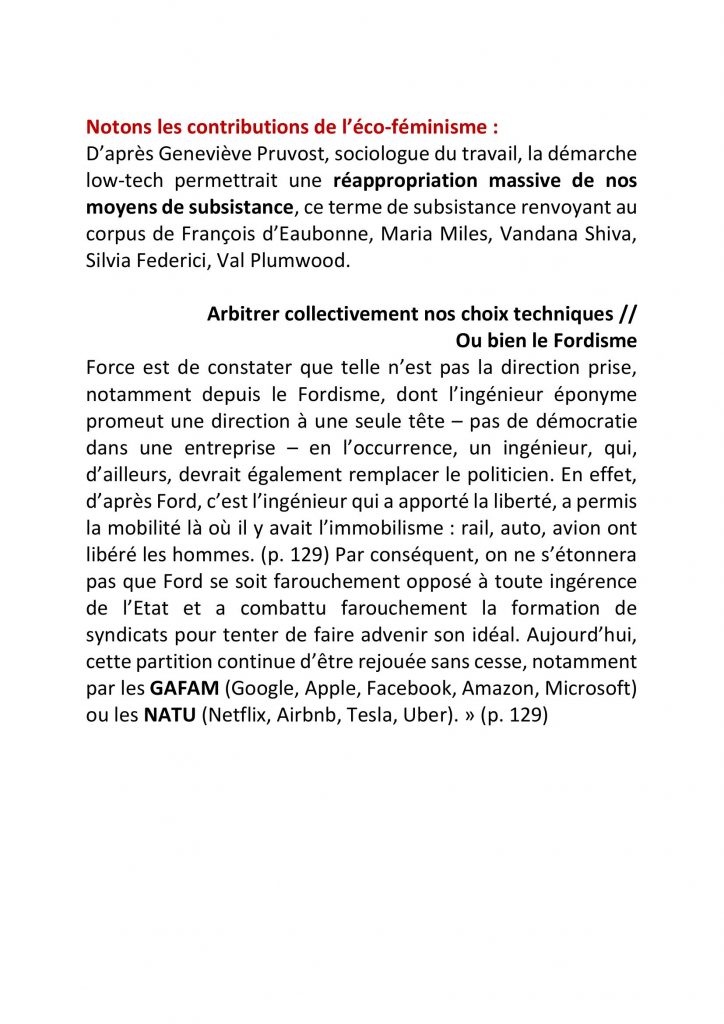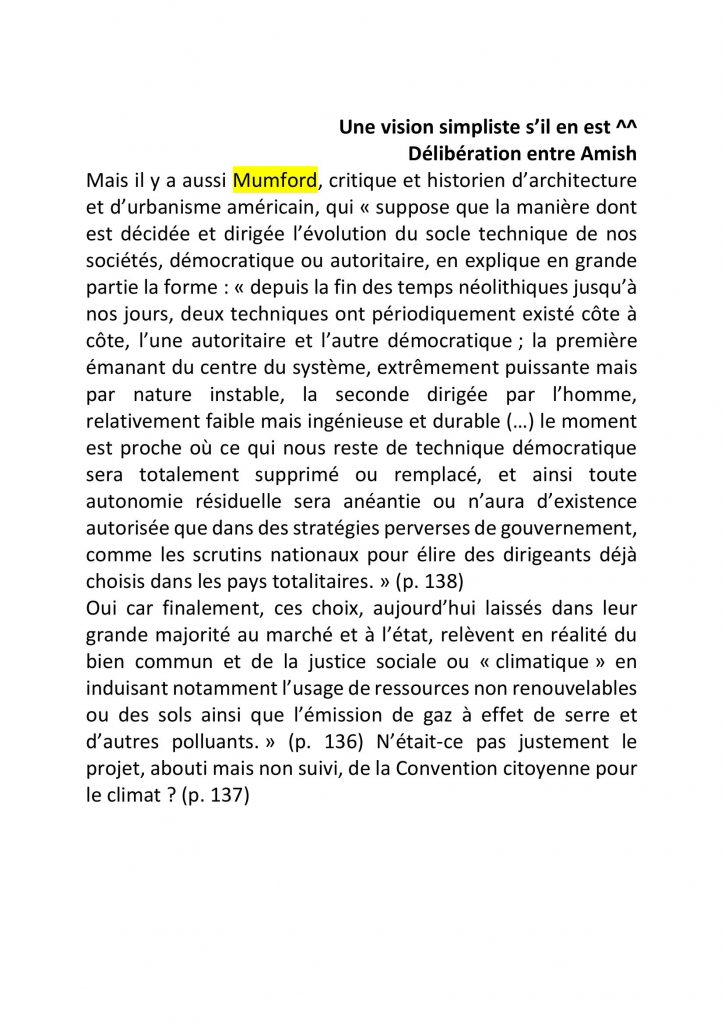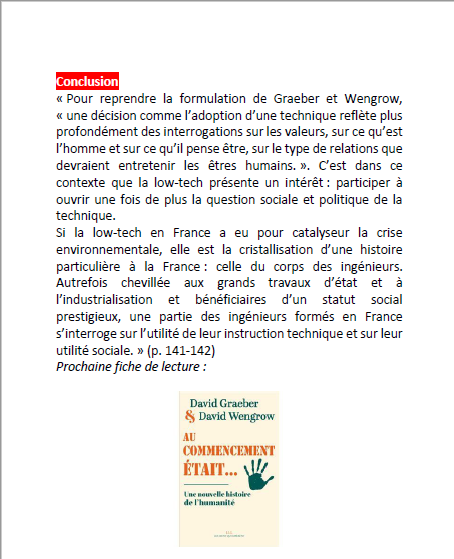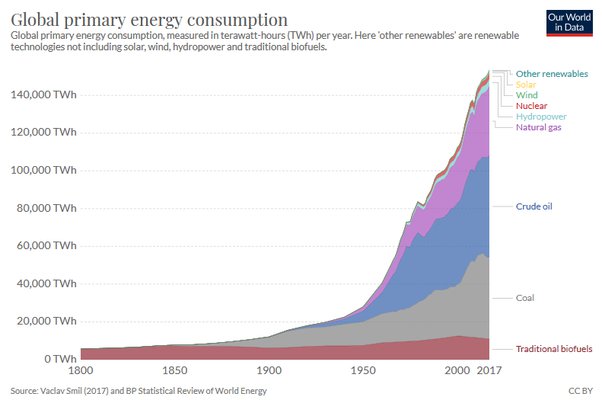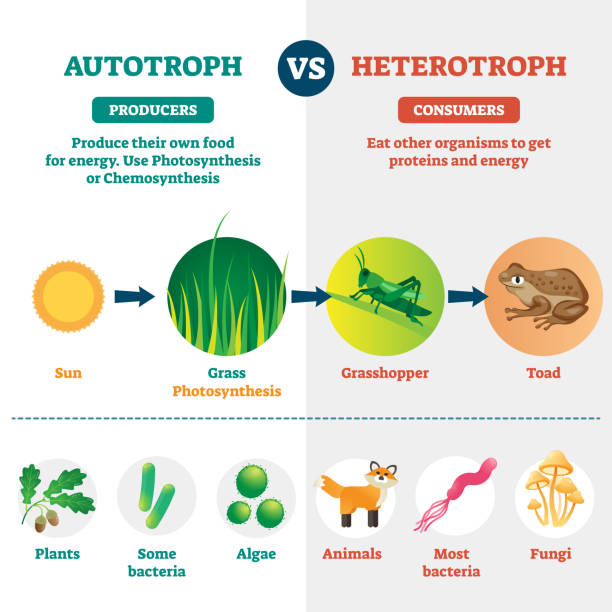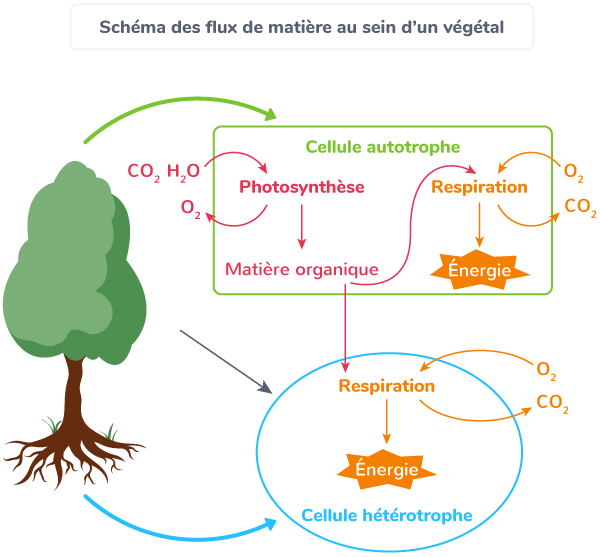Vers la fin de ce passionnant témoignage bigarré, Louise Michel rapporte ce qu’on dit d’elle à son procès :
Un portrait
« Il y a entre elle et Théroigne de Méricourt, la bacchante furieuse de la Terreur, des points de ressemblance… » « Louise Michel est le type révolutionnaire par excellence, elle a joué un grand rôle dans la Commune ; on peut dire qu’elle en était l’inspiratrice, sinon le souffle révolutionnaire (…) Son front est développé et fuyant ; son nez large à la base lui donne un air peu intelligent ; ses cheveux sont bruns et abondants. Ce qu’elle a de plus remarquable, ce sont ses grands yeux d’une fixité presque fascinatrice. Elle regarde ses juges avec calme et assurance. » (p. 365)
Jugement des hommes probablement, qui furent d’ailleurs assez déroutés par la présence des femmes dans les insurrections que Louise Michel ne cesse de souligner ; merci à elle !
Les femmes
« Parmi les plus implacables lutteurs qui combattirent l’invasion et défendirent la République comme l’aurore de la liberté, les femmes sont en nombre.
On a voulu faire des femmes une caste, et sous la force qui les écrase à travers les événements, la sélection s’est faite ; on ne nous a pas consultées pour cela et nous n’avons à consulter personne. Le monde nous réunira à l’humanité libre dans laquelle chaque être aura sa place. » (p. 165) « Pourquoi étais-je là une privilégiée ? Je n’en sais rien, il est vrai, peut-être que les femmes aiment les révoltes. Nous ne valons pas mieux que les hommes, mais le pouvoir ne nous a pas encore corrompues. » (p. 167)
Louise Michel étaient institutrice : « Il y avait à ce moment à ma classe presque deux cents élèves, des fillettes de six à douze ans que nous instruisions ma sous-maîtresse et moi, et de tout petits enfants de trois à six ans (…) on a souvent parlé des jalousies entre institutrices, je ne les ai pas éprouvées ; avant la guerre nous faisions des échanges de leçons avec ma plus proche voisine, mademoiselle Potin donnant les leçons de dessin chez moi, et moi les leçons de musique chez elle, conduisant tantôt l’une tantôt l’autre nos plus grandes élèves aux cours de la rue Hautefeuille. Pendant le siège, elle fit ma classe, lorsque j’étais en prison. » (p. 169)
Louise Michel a lutté et passé pas mal de temps en prison et en exil.
Elle note inlassablement le rôle prépondérant des femmes, notamment dans la prise d’armes du 18 mars (p. 178) « Nous pensions mourir pour la liberté. (…) Tout à coup, je vis ma mère près de moi et je sentis une épouvantable angoisse : inquiète, elle était venue, toutes les femmes étaient là, montées en même temps que nous, je ne sais comment.
Ce n’était pas la mort qui nous attendait sur les buttes où déjà pourtant l’armée attelait les canons (…) mais la surprise d’une victoire populaire. »
Elle raconte ici l’événement du 18 mars où la Garde Nationale fraternise finalement avec les Communeux.ses en révolte.
Peu attentive, pour ma part, aux noms et aux précisions militaires, je suis en revanche fort sensible aux aspects matériels et humains du récit de Louise Michel, entêté dans une liberté de ton qui mêle songeries, réflexion, souvenirs, faits et sentiments, tendresse.
Où est le manifeste anarchiste-communiste de la Commune ?
Je m’attendais à un livre révolutionnaire, un manifeste, un vademecum du changement et du progrès ! On l’y trouve toutefois, à la toute fin de cette édition, dans les appendices :
Aux Communeux, publiés par les proscrits de Londres en 1874
Et c’est fort inspirant. Respirez en le lisant et le relisant.
Mais ce n’est pas de Louise Michel. Sur l’ensemble du récit La Commune, le chapitre éponyme n’en représente qu’un quart. L’avant est long, l’après, la défaite, est poignante et nous y reviendrons. Quelques pages seulement, au centre, pour décrire dans les grandes lignes ce que furent la réalisation et la mise en pratique, de la commune.
Les premières mesures de la Commune vont à l’instruction : « Partout des cours étaient ouverts, répondant à l’ardeur de la jeunesse. On voulait tout à la fois, arts, sciences, littérature, découvertes, la vie flamboyait. On avait hâte de s’échapper du vieux monde. » (p. 208)
Les établissements publics reçoivent alors des fonds et les communards regrettent que les banques ne soient pas déjà nationalisées, sans quoi ils auraient eu davantage encore à redistribuer.
Un petit chapitre où sont entassées les premières mesures, qui rendent l’argent. Parmi celles-ci, notable : « Des pensions alimentaires pour les fédérés blessés en combattant réversibles à la femme, légitime ou non, à l’enfant, reconnu ou non, de tout fédéré tué en combattant ». (p. 204) Mais également les premiers décrets de la lutte pour la laïcité dont elle dit : « l’abolition du budget des cultes et de la conscription ; on s’imaginait alors, on s’imagine peut-être encore, que le mauvais ménage de l’Eglise et de l’Etat, qui derrière eux traînent tant de cadavres, pourraient jamais être séparés (sic) : c’est ensemble seulement, qu’ils doivent en disparaître. » (p. 204) On récupère les ateliers abandonnés, on paye mieux les instituteurs et institutrices, on rémunère de façon juste les nouveaux élus. Pour les femmes : « la femme qui demandait contre son mari la séparation de corps, appuyée sur des preuves valables, avait droit à une pension alimentaire. » (p. 205) et enfin, l’instruction et la science, l’école gratuite pour tous les enfants de la Commune. C’est le chapitre V : premiers jours de la Commune, les mesures et la Vie à Paris.
Un tel programme pourrait nous paraître bel et bien acquis aujourd’hui et pourtant, tout comme on nous serine « des gens se sont battus pour le droit de vote », on pourrait rappeler et chanter sans cesse que bien des gens sont morts pour cette solidarité, ce savoir partagé, cette égalité de traitement – à noter : la pension alimentaire pour la femme qui ne travaillait pas, quelques dizaines d’années après l’horrible code civil.
La lutte
C’est un authentique et poignant récit de lutte permanente pour la liberté, les mots sont près du sol, du froid, de la boue, des baïonnettes, et ceux qui me frappent par leur grande fréquence sont trahison et sang.
« L’empire, les griffes saignantes, s’accrochait toujours. » (p. 42)
« Rouge était le soleil levant » (p. 48) inaugure le chapitre « Réveil ». Les difficiles luttes commencent (ou continuent), Louise Michel est alors âgée de 40 ans, elle n’est pas une jeunette, et pourtant il semble que sa vie commence à la Commune. Voici quelques passages inspirants et même roboratifs ; je suis frappée par une si belle écriture :
« Assez de lâcheté, les lâches sont des traitres,
Foule vile, bois, mange et dors :
Puisque tu veux attendre, attends, léchant tes maîtres,
N’as-tu donc pas assez de morts ? »
(p. 52)
Sur la guerre, qu’on entraîne les pauvres à faire :
« puisqu’il faut des combats, puisqu’on veut la guerre,
Peuples, le front courbé, plus tristes que la mort,
C’est contre les tyrans qu’ensemble il faut la faire :
Bonaparte et Guillaume auront le même sort. » L.M. 1870 (p. 58)
On y trouve rapportées la mort et l’enterrement de Victor Noir, extrait de Les aventures de ma vie de Henri Rochefort, suivi d’une ambiance de fin de règne, qu’on ne saurait que trop reconnaître :
« Comme les gouvernants qui ont besoin de détourner d’eux l’opinion publique, l’Empire faisait autour de lui un bruit continuel : complots, qu’il échafaudait lui-même : bombes, données par des mouchards ; scandales ; crimes, découverts en temps opportun, que depuis longtemps on connaissait et tenait en réserve, ils abondent à certaines fins de règne. » (p. 86)
C’est parce que c’est la fin que les choses deviennent pires. » (p. 419)
Voici le récit passionné de l’avènement d’une nouvelle République qui suit ; des prisonniers cependant, des mécontents, de l’espoir. C’est un peu partout en France que la Commune s’impose : « Strasbourg, investie le 13 août, ne s’était pas encore rendue le 18 septembre. Comme on était ce jour-là dans Paris plus angoissé, sentant l’agonie de Strasbourg qui, blessée, bombardée de toutes parts, ne voulait pas mourir, l’idée nous plut à quelques-uns, plutôt quelques-unes, car nous étions en majorité des femmes, d’obtenir des armes et de partir à travers tout pour aider Strasbourg à se défendre ou mourir avec elle. (…) Bon nombre d’institutrices étaient venues ; il y en avait de la rue du Faubourg-du-Temple que j’ai revues depuis, j’y rencontrai pour la première fois madame Vincent qui peut-être garda de cette manifestation l’idée de groupements féminins » (p. 113-114) A la suite de quoi toutes se retrouve piégées et emprisonnées. Louise arpente les rues avec son amis André Léo.
Face au risque permanent, Louise Michel est armée : « Je déposais d’ordinaire près de moi sur le bureau un petit vieux pistolet sans chien, qui habilement placé et saisi au bon moment arrêta souvent les gens de l’ordre qui arrivaient, frappant à terre leurs fusils ornés de la baïonnette. » (p. 131)
Des placards dans les rues, pas d’armistice, pas d’amnistie, résistance à mort, déchéance du gouvernement, La Commune, Vive la République. (p. 122) et là-dedans, les Bretons sont décrits comme des étrangers à la cause :
« A l’hôtel de Ville, les mobiles bretons, leurs yeux bleus fixés dans le vague, se demandaient si M. Trochu ne débarrasserait pas bientôt la France des criminels qui y causaient tant de désastres afin qu’il leur fût permis de revoir la mer, les rochers de granit durs comme leurs crânes, les landes où s’ébattent les poulpiquets et de danser aux pardons les jours où Armor est en fête. » (p. 127)
« Les voilà revêtus du linceul de l’Empire,
S’y ensevelissant et la France avec eux,
Et le nain Foutriquet, et le gnome fatidique
Cousant le voile horrible avec ses doigts hideux.
Oui, c’était bien l’Empire ! les prisons pleines, la peur et les délations à l’ordre du jour, les défaites changées en victoire sur les affiches. Les sorties refusées ; le nom du vieux Blanqui secoué comme un épouvantail devant la bêtise humaine. » (p. 128)
Puis la fin, rapide : « à cette besogne, qui devait être faite seulement dans la rage du combat, on employa l’armée, ivre de mensonges, de sang et de vin ; l’Assemblée et les officiers supérieurs sonnant l’hallali. Paris fut servi au couteau. » (p. 213) Les Communes des Provinces tombent aussi, notamment à cause des pouvoirs en place : « l’institution des préfectures est funeste à la liberté » (P 235) Marseille, Saint-Etienne, Narbonne, Lyon furent écrasées. Des villes envoyèrent par millions des lettres de réprobation à Versailles. (p. 241) « La Commune était alors la forme qui semblait la plus facile pour assurer la liberté. » (p. 242) « Toutes les villes de France demandaient la fin des tueries (elles ne faisaient que commencer) » (p 245)
« A Limoges, le 4 avril, les soldats d’un régiment de ligne qui y étaient casernés ayant reçu l’ordre d’aller renforcer l’armée de Versailles, la foule les conduisit à la gare, leur fit jurer de ne pas s’employer à l’égorgement de Paris, ils le jurèrent en effet, et remirent leurs armes à ceux qui les reconduisaient, puis retournèrent à la caserne, où devant leurs officiers la ville tout entière leur fit une ovation. » (p. 246)
Et l’on constate toujours les mêmes ressorts :
« Il y a en effet un complot, organisé pour exciter à la haine des citoyens les uns contre les autres, et pour faire succéder à la guerre contre l’étranger la hideuse guerre civile. Les auteurs de cette criminelle tentative sont les drôles qui se gratifient indûment du titre de défenseurs de l’ordre, de la famille et de la propriété. In l’Emancipation de Toulouse » (p. 248)
Et en effet les publications de Thiers n’en finissent pas d’invoquer l’ordre : la cause de l’ordre, le parti de l’Ordre, l’Ordre social (p. 257)
On est pourtant prévenu contre ce programme à venir, celui de Versailles, celui de L’ordre :
« Ce programme, c’est l’esclavage à perpétuité, c’est l’avilissement de tout ce qui est peuple ; c’est l’étouffement de l’intelligence et de la justice ; c’est le travail mercenaire ; c’est le collier de misère rivé à vos cous ; c’est la menace à chaque ligne ; on y demande votre sang, celui de votre femme, celui de vos enfants, on y demande nos têtes comme si nos têtes pouvaient boucher les trous qu’ils font dans vos poitrines, comme si nos têtes tombées pouvaient ressusciter ceux qu’ils vous ont tués. Ce programme, c’est le peuple à l’état de bête de somme, ne travaillant que pour un amas d’exploiteurs et de parasites, que pour engraisser des têtes couronnées, des ministres, des sénateurs, des maréchaux, des archevêques et des jésuites. » (p. 281) « vivre libre ou mourir. » (p. 282)
« Mais l’égorgement commençait en silence. » (p. 292) « Drapeau rouge en tête, les femmes étaient passées : elles avaient leur barricade place Blanche, il y avait là Elisabeth Dmitrieff, madame Lemel, Malvina Poulain, Blanche Lefebvre, Excoffon, André Léo étaient à celle des Batignolles. Plus de dix mille femmes aux jours de mai, éparses ou ensemble, combattirent pour la liberté. » (p. 296)
C’est le retour sanglant de la bourgeoisie, et avec elle, ce sont les mille et mille rois de la Finance… (p. 298) « Quelques enfants, sur les bras des mères, étaient fusillés avec elles, les trottoirs étaient bordés de cadavres. » (p. 304)
La tuerie de masse – Louise Michel se déguise en bourgeoise pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté du front – les prisonnières qui boivent dans les bidons d’eau jaunâtre, « prise à la mare de la cour : dans cette mare, les vainqueurs lavaient leurs mains sanglantes et faisaient leurs ordures. Les bords charriaient une écume rose » (p. 330) et dans la prison des femmes, où elle ira : « sur le plancher serpentaient de petits filets argentés, formaient des courants entre de véritables lacs, grands comme des fourmilières et remplis comme des ruisselets d’un fourmillement nacré. C’étaient des poux ! énormes, au dos hérissé et un peu bombé, quelque chose de pareil à des sangliers qui auraient eu la taille d’une toute petite mouche ; il y en avait tant qu’on entendait le fourmillement. » (p. 334)
Après la prison à Satory puis déportation. Sur les drapeaux et sur les murs :
« Vivre en travaillant ou mourir en combattant. » (p. 368)
Voyage sur la Virginie où elle peut échanger avec Madame Lemel : « Entre deux éclaircies de calme où elle ne se trouvait pas trop mal, je faisais part à madame Lemel de ma pensée sur l’impossibilité que n’importe quels hommes au pouvoir pussent jamais faire autre chose que commettre des crimes, s’ils sont faibles ou égoïstes ; être annihilés s’ils sont dévoués et énergiques ; elle me répondit : « c’est aussi ce que je pense ! » et j’avais beaucoup confiance en la rectitude de son esprit, et son approbation me fit grand plaisir. » (p. 385)
En Nouvelle-Calédonie, elle enseigne, elle lit, elle apprend, elle admire – pour partir, elle menace d’aider la révolte des canaques en la racontant partout et comment se comporte l’administration française là-bas. Elle est connue et crainte. Elle repart en France où elle est accueillie par des milliers de personnes.
L’espoir vissé au corps – au cœur
Louise Michel, partout, essaime son récit d’espoir et d’optimisme.
Elle cite un certain Docteur Pallay, de l’Université d’Oxford, à propos de la Commune, disant que la misère ne doit pas disparaître avec l’extinction des malheureux mais bien plutôt par la participation de tous à la vie : « L’Antiquité, disait-il, est morte d’avoir conservé dans ses flancs la plaie de l’esclavage. L’ère moderne fera son temps si elle persiste à croire que tous doivent travailler et s’imposer des privations, pour procurer le luxe à quelques-uns. » (p. 63)
Et puis un extrait des lettres des Internationaux français : « Travailleurs de tous les pays, quoi qu’il arrive de nos efforts communs, nous, membres de l’Internationale des Travailleurs, qui ne connaissons plus de frontières, nous vous adressons comme un gage de solidarité indissoluble les vœux et les saluts des travailleurs de France. » (p. 68)
On trouve critique de la religion, et c’est surtout une critique de l’ivresse, l’ivresse mystique, l’ivresse du sang, « dans toutes les ivresses se font de monstrueuses choses. » « Ce sont des épidémies morales pires que la peste, mais qui disparaitront avec l’assainissement des esprits dans la consciente liberté. » (p. 267) Et pourtant, « Quelle conciliation en effet peut exister entre le long esclavage et la délivrance. Dans dix ou douze églises, montait tous les soirs un chœur immense saluant la liberté. J’en entendis parler avec enthousiasme. Les femmes surtout y exhortaient à la liberté. » (p. 275)
Dieu est démasqué : « et ne me parlez plus de Dieu, le croquemitaine ne nous effraie plus, il y a trop longtemps qu’il n’est plus que prétexte à pillage et assassinat. » (p. 354)
« Souvent, au fond de ma pensée passe l’appel des noms au club de la Révolution – c’est l’appel des spectres, mais voir le progrès éternel, c’est en quelques heures vivre éternellement. » (p. 135)
« Un souffle de tempête les semait, elles ont ramifié, grandissant dans l’ombre et à travers les égorgements, elles sont aujourd’hui en fleur ; les fruits viendront.
Vers 70, avant, après, toujours, jusqu’à ce que soit accomplie la transformation du monde, l’attirance vers l’idéal vrai continue.
Est-ce qu’on peut empêcher le printemps de venir, lors même qu’on couperait toutes les forêts du monde ?
Vers 70, Cuba, la Grèce, l’Espagne revendiquaient leur liberté : partout, les Esclaves allaient secouant leurs chaînes, les Indes comme aujourd’hui se soulevaient pour la liberté.
Les cœurs montaient assoiffés d’idéal ; tandis que les maîtres plus implacables armaient leurs meutes inconscientes, les entraînant sur le gibier humain, toujours noyée dans le sang, la révolte renaissait sans cesse ; c’était partout une marée montante vers l’étape nouvelle et plus haute, en vue toujours sans qu’elle soit encore atteinte.
Les répressions déchaînées, plus féroces et plus stupides à mesure que la fin arrive, sollicitaient, comme nous le voyons encore, le pouvoir affolé et croulant.
En novembre 70, les cachots de Russie regorgeaient. Des hommes, des femmes appartenant comme grand nombre d’entre eux à la jeunesse des écoles avaient adhéré à l’Internationale ; ils essayaient d’éveiller les moujiks courbés depuis si longtemps sur la dure zemlia. » (p. 161)
« c’est que le pouvoir est maudit, c’est pour cela que je suis anarchiste. » (p. 201)
« Minute par minute, le vieux monde s’enlise davantage, l’éclosion de l’ère nouvelle est imminente et fatale, rien ne peut l’empêcher, rien que la mort.
Seul un cataclysme universel empêcherait l’éocène qui se prépare.
Les groupes humains en sont arrivés à l’humanité consciente et libre : c’est l’aboutissement.
Les juges vendus peuvent recommencer les procès de malfaiteurs pour les plus honnêtes, faire asseoir des innocents au prétoire, en laissant les vrais coupables comblés de ce qu’on appelle les honneurs, les dirigeants peuvent appeler à leur aide tous les inconscients esclaves, rien, rien n’y fera, il faut que le jour se lève et il se lèvera. » (p. 419)
« Nous sommes aujourd’hui plus asservis que le jour où l’Assemblée de Versailles trouva trop libéral le gnome Foutriquet, mais l’idée se fait plus libre et plus haute toujours. (…) Haut les cœurs ! Pour la sainte indépendance, camarades, levons-nous !
Aujourd’hui 2 janvier 1898 où je termine ce livre, la photographie ouvre la route, les rayons X qui permettrent de voir à travers les chairs, ce qui tue la vivisection au moment où disparaît la férocité chez les peuples, pense-t-on que la volonté, l’intelligence humaine ne sera pas libre ? (…)
Les mondes aussi, grâce à la science, livreront leurs secrets et ce sera la fin des dieux. L’éternité avant et après nous, dans l’infini des sphères poursuivant comme les êtres leurs transformations éternelles. Courage, voici le germinal séculaire.
Que cela paraisse ou non possible à ceux qui ne veulent pas voir voguer dans nos toruments les premiers rameaux verts arrachés à la rive nouvelle, la désagrégation de la vieille société se hâte.
Avant que sur le livre de pierre ou sur la tombe de Pottier on ait gravé ces vers terribles :
Je suis la vieille anthropophage
Travestie en société
Vois mes mains rouges de carnage,
Mon œil de luxure injecté.
J’ai plus d’un coin dans mon repaire
Plein de charogne, et d’ossements,
Viens les voir ; j’ai mangé ton père,
Et je mangerai tes enfants.
Pottier
Oui, avant même que la malédiction soit gravée, la vieille société ogresse peut-être sera morte, l’heure étant venue de l’humanité juste et libre, elle a trop grandi pour rentrer dans son sanglant berceau. » (p. 425)
Notes pour plus tard : penser à relire Vallès, Elisée Reclus, Eugène Varlin et autres…
Editions La Découverte Poche – conforme au texte de l’édition originale Paris Stock 1898