Les notes que je propose sur ce livre important de Bourdieu sont longues ! il y avait beaucoup à dire et à citer. Parfois, j’ai commenté (en violet). Globalement, j’ai rapporté en tâchant d’être fidèle, même si concise ou synthétique.
Introduction générale
Le livre s’ouvre de façon plaisante sur un exemple fourni par Kant qu’il faut découvrir absolument :
« Dans l’Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, Kant imagine un homme de dix degrés d’avarice qui s’efforce de douze degrés vers l’amour du prochain tandis qu’un autre, avare de trois degrés, et capable d’une intention conforme de sept degrés, produit une action généreuse de quatre degrés : pour conclure que le premier est moralement supérieur au second bien que, mesuré à l’acte – deux degrés contre quatre -, il soit indiscutablement inférieur. »
Autrement dit, lorsque vous êtes un sombre salopard, le moindre témoignage d’altruisme envers les autres est supérieur à toutes les actions de Mère Teresa parce qu’à elle, voyez-vous, ça ne coûte rien !
On pourrait en discuter des heures… du fait de savoir si Mère Térésa est elle-même par nature ou par contrainte ? Ou si le vieux salopard ne l’est que par paresse ? Si l’action compte, n’est-ce pas l’action que l’on doit prendre en compte ? Ou bien le résultat ?
Partant de cet exemple, P. Bourdieu suggère d’appliquer une telle arithmétique aux travaux scientifiques, et en particulier aux travaux des sciences sociales qu’il range du côté de l’avare de dix degrés.
J’ai cru que la convocation de Kant servirait à dénoncer la façon capillotractée de certaines théories en sciences humaines et sociales, mais non. Quoi qu’il en soit, il explique plus loin le tournant saussurien qui sépare la linguistique externe (qui s’intéresse à la langue et autre chose : langue et société, langue et histoire etc…) de la linguistique interne (qui s’intéresse à la langue et point barre). Cette dernière prend une place telle qu’il ne reste plus qu’elle de distinguée en sciences du langage. Mais parce que l’hétérogénéité sociale est inhérente à la langue.
« Il faut choisir de payer la vérité d’un coût plus élevé pour un profit de distinction plus faible. »
PREMIÈRE PARTIE
L’économie des échanges linguistiques
Introduction
En gros la linguistique a pris trop de place.
Néanmoins, les rapports de communication linguistique sont des rapports de pouvoir symbolique. On peut « élaborer une économie des échanges symboliques ». Mise en garde de Bourdieu à l’adresse des linguistes :
« … aussi longtemps qu’ils ignorent la limite qui est constitutive de leur science, les linguistes n’ont d’autre choix que de chercher désespérément dans la langue ce qui est inscrit dans les relations sociales où elle fonctionne, ou de faire de la sociologie dans le savoir, c’est-à-dire avec le danger de découvrir dans la grammaire même ce que la sociologie spontanée du linguiste y a inconsciemment importé. » (p. 60)
En réalité, le sens d’un mot tel qu’il est donné dans le dictionnaire n’existe pas.
« Les différents sens d’un mot se définissent dans la relation entre le noyau invariant et la logique spécifique des différents marchés, eux-mêmes objectivement situés par rapport au marché où se définit le sens le plus commun. Ils n’existent simultanément que pour la conscience savante qui les fait surgir en brisant la solidarité organique entre la compétence et le mot. »(p. 63)
Vendryès : « si les mots recevaient toujours tous leurs sens à la fois, le discours serait un jeu de mots continué. »
Bakhtine : il n’y a pas de mots neutres.
D’ailleurs, la religion et la politique s’emparant de la polysémie à des fins idéologiques l’ont bien compris.
Il existe un langage neutralisé qui
« s’impose toutes les fois qu’il s’agit d’établir un consensus pratique entre des agents ou des groupes d’agents dotés d’intérêts partiellement ou totalement différents ».
Néanmoins
« Toutes les théologies religieuses et toutes les théodicées politiques ont tiré parti du fait que les capacités génératives de la langue peuvent excéder les limites de l’intuition ou de la vérification empirique pour produire des discours formellement corrects mais sémantiquement vides. » (p. 65)
« Le discours juridique est une parole créatrice, qui fait exister ce qu’elle énonce. »
(p. 66)
- La production et la reproduction de la langue légitime
Langue officielle et unité politique
La langue standard : un produit « normalisé »
Dans ces premières pages, Bourdieu explique comment la langue arbitrairement (ou du moins historiquement) désignée comme légitime est celle du dominant, intellectuel principalement. Elle est donc une arme de discrimination ou un moyen de reconnaissance entre pairs ; elle est aussi un moyen d’humiliation ou de valorisation, un adjuvant au bluff ou un traitre et révélateur des origines… mais n’entendons pas seulement la langue au sens du lexique (argot ou soutenu) ; il ne faut pas négliger la prononciation, les accents et tous les tics verbaux et non-verbaux, le regard etc.
De même, les dialectes sont devenus des patois au sens péjoratif du terme par une volonté politique.
Pour qu’une langue devienne légitime, elle doit être écrite, fixée, mais surtout enseignée :
(p. 75) « La théorie whorfienne – ou, si l’on veut, humboldtienne – du langage qui soutient cette vision de l’action scolaire comme instrument d' »intégration intellectuelle et morale », au sens de Durkheim, présente avec la philosophie durkheimienne du consensus une affinité au demeurant attestée par le glissement qui a conduit le mot code du droit à la linguistique : le code, au sens de chiffre, qui régit la langue écrite, identifiée à la langue correcte, par opposition à la langue parlée (conversational language), implicitement tenue pour inférieure, acquiert force de loi dans et par le système d’enseignement. »
C’est l’école qui a ravalé les dialectes à des patois, par le biais des fonctionnaires d’état, représentant les dominants.
L’unification du marché et la domination symbolique
Bourdieu explique ainsi comment les femmes acquièrent plus facilement le langage et les langues…
(p.78) « Et l’on comprend ainsi que, comme les sociolinguistes l’ont souvent obsevré, les femmes soient plis promptes à adopter la langue légitime (ou la prononciation légitime) : du fait qu’elles sont vouées à la docilité à l’égard des usages dominants et par la division du travail entre les sexes, qui les spécialise dans le domaine de la consommation, et par la logique du mariage, qui est pour elles la voie principale, sinon exclusive de l’ascension sociale, et où elles circulent de bas en haut, elles sont prédisposées à accepter et d’abord à l’École, les nouvelles exigences du marché des biens symboliques. »
Bon, il y aurait quand même beaucoup à commenter ici… 1) du fait qu’aujourd’hui les femmes travaillent comme les hommes, à l’extérieur du foyer… 2) que les précieuses (pas si ridicules) auxquelles on avait pourtant interdit l’apprentissage du latin et la culture tout court, s’était inventé une orthographe bien à elles… 3) que les femmes, moins avides de pouvoir durant des siècles (c’est sans doute différent aujourd’hui dans certaines parties du monde) n’ont eu aucun intérêt à se conformer aux exigences du marché des biens symboliques… contrairement aux hommes, toujours avides de carrière et de reconnaissance sociale. Ils sont peut-être juste moins doués ? 4) qu’il existe une langue des femmes, inventée par elles, et particulièrement truculente quand elle parle des hommes, entendus comme les oppresseurs.
Écarts distinctifs et valeur sociale
Le champ littéraire et la lutte pour l’autorité linguistique
Certains écrivains jouent main dans la main avec les grammairiens et les dominants. Même quand ils déconstruisent la langue, cela n’est remarquable et remarqué que parce que la langue du dominant est imposée et connue. Pourtant les écrivains, pour beaucoup, aiment à imiter la langue des dominés. Mais en réalité, elle n’en a pas l’authenticité.
(p.135) « Dans leur souci de le traiter comme une « langue » – c’est-à-dire avec toute la rigueur que l’on réserve d’ordinaire à la langue légitime -, tous ceux qui ont tenté de décrire ou d’écrire le pop., linguistes ou écrivains, se sont condamnés à produire des artefacts à peu près sans rapport avec le parler ordinaire que les locuteurs les plus étrangers à la langue légitime emploient dans leurs échanges internes. »
Tout se passe donc comme si, pour le dire d’une façon extrêmement simplifiée (p. 146, Bourdieu le précise lui-même « Malgré l’énorme simplifications qu’il suppose, ce modèle fait voir l’extrême diversité des discours qui s’engendrent »), le discours des dits dominants et le discours des dits dominés se créent mutuellement l’un l’autre par un jeu d’opposition permanent qui entretient la frontière. Le maître du premier sera mal à l’aise dans le contexte où règne les maîtres du second, et vice versa.
Les deux discours peuvent être à égalité en capital symbolique, mais la société veut que le maître du discours dit dominant soit en capacité de corriger le discours du dominé avec des « on ne dit pas » car
(p. 144) « Nul ne peut ignorer complètement la loi linguistique ou culturelle et toutes les fois qu’ils entrent dans un échange avec des détenteurs de la compétence légitime et surtout qu’ils se trouvent placés en situation officielle, les dominés sont condamnés à une reconnaissance pratique, corporelle, des lois de formation des prix les plus défavorables à leur productions linguistiques qui les condamne à un effet plus ou moins désespéré vers la correction ou au silence. »
Au cœur de cette comédie, les femmes, d’après Bourdieu, jouent un rôle primordiale de passeuse mais aussi de détentrices de la parole embarrassée ; ce sont souvent elles qui sont au contact du médecin :
(p. 149) « Parce qu’il est admis (et d’abord par les femmes, qui peuvent feindre de le déplorer) que l’homme est défini par le droit et le devoir de constance à soi qui est constitutif de son identité (« il est comme il est ») et qu’il peut s’en tenir à un silence propre à lui permettre de sauvegarder sa dignité virile, il incombe souvent à la femme, socialement définie comme souple et soumise par nature, de faire l’effort nécessaire pour affronter les situations périlleuses, recevoir le médecin, lui décrire les symptômes et discuter avec lui au sujet du traitement, faire des démarches auprès de l’institutrice ou de la sécurité sociale, etc. »
Bourdieu estime que les femmes prennent le risque de faire des « fautes » et d’être corrigées parce que, socialement, cela leur en coûterait moins (cf Kant et remarque préliminaire) puisqu’elles sont habituées à être tenues pour inférieures… néanmoins, nous pourrions imaginer qu’elles sont simplement plus courageuses, qu’elles ne craignent pas d’affronter la réalité de leur situation ou qu’elles pensent maîtriser suffisamment la langue du dominant pour communiquer avec lui, quitte à se tromper. Ou qu’elles sont moins soumises au mirage des miroirs aux alouettes…
Il lui oppose l’homme, et comme parangon de la révolte « virile » le patron de bar, qu’il décrit en 2 pages laudatives et qui est censé maîtriser le discours plus populaire, d’une part en réaction contre la langue du dominant, d’autre part en réaction contre la langue des femmes, qui pourraient être assimilées l’une à l’autre. Mais cette langue du dominé n’est pas non plus un espace de liberté ; elle est aussi extrêmement codifiée :
(p. 148) « On comprend que le discours qui a cours sur ce marché ne donne les apparences de la liberté totale et du naturel absolu qu’à ceux qui en ignorent les règles ou les principes : ainsi l’éloquence que la perception étrangère appréhende comme une sorte de verve débridée n’est ni plus ni moins libre en son genre que les improvisations de l’éloquence académique […] [le discours du dominé s’assigne à stabiliser un certain ordre], peut-être parce que le culte de la virilité, c’est-à-dire de la rudesse, de la force physique et de la grossièreté bourrue, instituée en refus électif du raffinement efféminé est une des manières les plus efficaces de lutter contre l’infériorité culturelle dans laquelle se rencontrent tous ceux qui se sentent démunis de ce capital culturel, qu’ils soient par ailleurs riches de capital économique, comme les commerçants, ou non. »
Une question me poursuit depuis la lecture de ce chapitre : qu’enseigne-t-on à nos collégiens et lycéens, si ce n’est la langue de l’écrivain, qui elle, surfe et se joue des codes depuis le départ… Montaigne qui a souhaité conserver l’orthographe antienne et le précise à son éditeur d’alors, Proust qui représente le détenteur du discours dominant, le post-modernisme qui déconstruit les règles académiques… mais apprennent-ils les règles simples du discours académiques ? d’un discours à prétentions objectives et scientifiques par exemple ? Bourdieu revient là-dessus plus tard.
- Les rites d’institution
(p. 176) Parler de rite d’institution, c’est indiquer que tout rite tend à consacrer ou à légitimer, c’est-à-dire à faire méconnaître en tant qu’arbitraire et reconnaître en tant que légitime, naturelle, une limite arbitraire ; ou ce qui revient au même, à opérer solennellement, c’est-à-dire de manière licite et extraordinaire, une transgression des limites constitutives de l’ordre social et de l’ordre mental qu’il s’agit de sauvegarder à tout prix.
(p.180) « L’acte d’institution est un acte de communication mais d’une espèce particulière : il signifie à quelqu’un son identité, mais au sens à la fois où il la lui exprime et la lui impose en l’exprimant à la face de tous (kategoresthai c’est à l’origine accuser publiquement) et en lui notifiant ainsi avec autorité ce qu’il est et ce qu’il a à être.
Seuls ceux qui se savent appartenir à la classe dite supérieure peuvent se permettre des licences de langue ou des comportements inappropriés.
- Décrire et prescrire : les conditions de possibilité et les limites de l’efficacité politique
faire de la politique, cela commence en dénonçant cette adhésion à l’ordre établi.
« La subversion politique présuppose une subversion cognitive, une conversion de la vision du monde ».
Cette vision du monde peut être imposée également par le discours politique et par le discours scientifique. Comme les « dominants » ne trouvent rien à redire à ce monde, « ils s’efforcent de d’imposer universellement, par un discours tout empreint de la simplicité et de la transparence du bon sens, le sentiment d’évidence et de nécessité que ce monde leur imposer ; ayant intérêt au laisser-faire, ils travaillent à annuler la politique dans un discours politique dépolitisé, produit d’un travail de neutralisation ou, mieux, de dénégation, qui vise à restaurer l’état d’innocence originaire de la doxa et qui, étant orienté vers la naturalisation de l’ordre social, emprunte toujours le langage de la nature. »
« Cette stratégie de la neutralité (éthique) trouve son accomplissement naturel dans la rhétorique de la scientificité. » (p. 193)
« La description scientifique la plus strictement constative est toujours exposée à fonctionner comme prescription capable de contribuer à sa propre vérification en exerçant un effet de théorie propre à favoriser l’avènement de ce qu’elle annonce. Au même titre que la formule : « la séance est ouverte », la thèse « il y a deux classes » peut être entendue comme un énoncé performatif. » (196)
TROISIÈME PARTIE : POUVOIR SYMBOLIQUE ET CHAMP POLITIQUE
- Sur le pouvoir symbolique
« Le pouvoir symbolique est en effet ce pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent pas savoir qu’ils le subissent ou même qu’ils l’exercent. »
- Les « systèmes symboliques » (art, religion, langue) en tant que structures structurantes
- Les « systèmes symboliques » en tant que structures structurées (justiciables d’une analyse structurale)
Première synthèse
« Instruments de connaissance et de communication, les « systèmes symboliques » ne peuvent exercer un pouvoir structurant que parce qu’ils sont structurés. le pouvoir symbolique est un pouvoir de construction de la réalité qui tend à établir un ordre gnoséologique : le sens immédiat du monde (et en particulier du monde social) suppose ce que Durkheim appelle le conformisme logique, c’est-à-dire « une conception homogène du temps, de l’espace, du nombre, de la cause, qui rend l’accord possible entre les intelligences ». (p205)
- Les productions symboliques comme instruments de domination
« Par opposition au mythe, produit collectif et collectivement approprié, les idéologies servent des intérêts particuliers qu’elles tendent à présenter comme des intérêts universels, communs à l’ensemble du groupe. La culture dominante contribue à l’intégration réelle de la classe dominante… » (p205/206)
Deuxième synthèse
Les « systèmes symboliques » remplissent leur fonction politique d’instruments d’imposition ou de légitimation de la domination « qui contribuent à assurer la domination d’une classe sur une autre (violence symbolique) en apportant le renfort de leur force propre aux rapports de force qui les fondent et en contribuant ainsi, selon le mot de Weber, à la « domestication des dominés ». (p. 206)
- Instruments de domination structurants parce que structurés, les systèmes idéologiques que les spécialistes produisent par et pour la lutte pour le monopole de la production idéologique légitime reproduisent sous une forme méconnaissable, par l’intermédiaire de l’homologie entre le champ de production idéologique et le champ des classes sociales, la structure du champ des classes sociales.
- La représentation politique
Compétences, enjeux et intérêt spécifiques
(p218) « La dépossession qui est corrélative de la concentration des moyens de production des instruments de production de discours ou d’actes socialement reconnus comme politiques n’a cessé de s’accroître à mesure que le champ de production idéologique gagnait en autonomie avec l’apparition des grandes bureaucraties politiques de professionnels à plein temps et avec l’apparition d’institutions (comme sciences po ou l’ENA) chargées de sélectionner et de former les producteurs professionnels de schèmes de pensée et d’expression du monde social, hommes politiques, analystes politiques, journalistes, hauts fonctionnaires, etc., en même temps que de codifier les règles du fonctionnement du champ de production politique et le corpus de savoir et de savoir-faire indispensables pour s’y conformer. »
Bourdieu plus loin soulève également l’importance du jeu entre pairs et les mécanismes de défense collective / solidaire qu’ils savent mettre en place dès que le jeu est dénoncé. (ex. la candidature de Coluche montrée du doigt comme poujadiste par le corps politique).
Le théâtre du monde social
Bourdieu cite Weber et, ici, donne un avis, semble-t-il, concernant ce qui devrait être…
(p.228) « Sans doute Max Weber a-t-il raison de rappeler, avec une saine brutalité matérialiste, qu’ « on ne peut vivre POUR la politique et DE la politique ». Mais pour être tout à fait rigoureux, il faudrait dire plutôt qu’on peut vivre de la politique à condition de vivre pour la politique. »
Malheureusement, ce n’est pas ce qui se passe. « Ils servent les intérêts de leurs clients dans la mesure (et dans la mesure seulement) où ils se servent aussi en les servant, c’est-à-dire d’autant plus exactement que leur position dans la structure du champ politique coïncide plus exactement avec la position de leurs clients dans la structure du champ social. »
Un système d’écarts
« La structure du champ, et la concurrence dont elle détermine la forme et les enjeux, contribuent, autant que la relation directe, et seule reconnue, aux clients, décrits comme mandants, à déterminer les prises de position, par l’intermédiaire des contraintes et des intérêts associés à une position déterminée dans le champ et dans la concurrence dont il est le lieu. » (p231)
La discrimination ou du moins, le souci de différencier les positions, est déterminante dans la constitution des partis. En tant de crise, on voit apparaître et émerger les petits partis, avec la chance de voir de nouveaux individus ; mais la plupart du temps, ce sont les gros appareils politiques qui luttent en s’opposant selon cette nécessité déterminante.
Mots d’ordre et idées-forces
« En politique, « dire c’est faire », c’est, plus exactement, se donner les moyens de faire en faisant croire que l’on peut faire ce qu’on dit, en faisant connaître et reconnaître des principes de vision et de division du monde social qui, comme les mots d’ordre, produisent leur propre vérification en produisant des groupes, et, par là, un ordre social. » (p. 239)
Crédit et croyance
« Le capital politique est une forme de capital symbolique, crédit fondé sur les innombrables opérations de crédit par lesquelles les agents confèrent à une personne (ou à un objet) socialement désignée comme digne de créance les pouvoirs mêmes qu’ils lui reconnaissent. Puissance objective qui peut être objectivée dans des choses (et en particulier dans tout ce qui fait la symbolique du pouvoir, trônes, sceptres et couronnes), à la façon de la fides telle que l’analyse Benveniste, le pouvoir symbolique est un pouvoir que celui qui le subit reconnaît en celui qui l’exerce et qu’il lui reconnaît. Credere, dit Benveniste, « c’est littéralement placer le KRED, c’est-à-dire la puissance magique en un être dont on attend protection, par suite croire en lui ». Sorte de fétiche, l’homme politique tient sa puissance proprement magique sur le groupe de la croyance du groupe dans la représentation qu’il donne au groupe et qui est une représentation du groupe lui-même et de sa relation aux autres groupes. »(p.241)
Les espèces du capital politique
Contrairement au capital personnel qui disparaît avec la personne, le capital politique (celui du prêtre, du fonctionnaire etc) perdure avec la fonction.
L’institutionnalisation du capital politique
« La délégation du capital politique présuppose l’objectivation de cette espèce de capital dans des institutions permanentes, sa matérialisation dans des « machines » politiques, dans des postes et des instruments de mobilisation, et sa reproduction continue par des mécanismes et des stratégies spécifiques. » (p248)
Mais Bourdieu (p250) semble expliquer comment et pourquoi l’homme, même le plus investi, se trouve finalement dépassé par le système et ses appareils.
Champs et appareils
Max Weber et Robert Michels notent la difficulté de ceux qui ont un capital culturel à briguer également un capital politique sous peine de voir leur capital culturel diminuer.
« Si l’on ajoute que les conditions sociales qui favorisent ou autorisent le refus de donner son temps à la politique ou à l’administration inclinent aussi, bien souvent, au dédain aristocratique ou prophétique pour les profits temporels que ces activités peuvent promettre ou procurer, on comprendre mieux certains des invariants structuraux de la relation entre les intellectuels d’appareil (politique, administratif ou autre) et les intellectuels libres (théologiens, chercheurs).
Notons en outre que certains militants doivent tout leur capital culturel au parti, notamment dans le parti communiste, tandis que d’autres sont déjà enseignants etc. comme bcp au parti socialiste.
- La délégation et le fétichisme politique
Citation de Bakounine (p. 259) de 1984 : « Les aristocrates de l’intelligence trouvent qu’il est des vérités qu’il n’est pas bon de dire au peuple. Moi, socialiste révolutionnaire, ennemi juré de toutes les aristocraties et de toutes les tutelles, je pense, au contraire, qu’il faut tout dire au peuple. Il n’y a pas d’autre moyen de lui rendre sa pleine liberté. »
Sur l’écart nécessaire et qui advient entre celui qui est délégué, le mandataire et le peuple. Cette fonction de représentation peut être usurpée et masquer la vérité. Celui qui est mandaté échappe au groupe, mais dans le même temps, il devient également la cible des quolibets, caricatures et autres moqueries. Il est davantage soumis au soupçon et à la défiance.
(p262) Par ailleurs, le délégué ou mandaté s’exprime au nom d’un groupe et l’on va le désigner, dans les journaux, par le nom du groupe qu’il représente « la CGT à l’Élysée ». Le groupe lui remet sa confiance, sa fides implicita comme on disait au moyen-âge.
« Plus les gens sont dépossédés, culturellement surtout, plus ils sont contraints et enclins à s’en remettre des mandataires pour avoir une parole politique. En fait, les individus à l’état isolé, silencieux, sans parole, n’ayant ni la capacité ni le pouvoir de se faire écouter, de se faire entendre, sont placés devant l’alternative de se taire ou d’être parlés. » (p.263)
L’autoconsécration du mandataire
Evidemment, les fonctionnaires par ex, sont les complices et dépositaires de ces systèmes de délégation, comme toute personne aveugle face à eux.
« Un pouvoir symbolique est un pouvoir qui suppose la reconnaissance, c’est-à-dire la méconnaissance de la violence qui s’exerce à travers lui. Donc la violence symbolique du ministre ne peut s’exercer qu’avec cette sorte de complicité que lui accordent, par l’effet de la méconnaissance qu’encourage la dénégation, ceux sur qui cette violence s’exerce. » (p266)
« La génération de la République »
Chez le mandaté ou le délégué, on retrouve la volonté presque christique de n’être rien avant de devenir tout.
« C’est lorsque je deviens Rien – et parce que je suis capabl de devenir Rien, de m’annuler, de m’oublier, de me sacrifier, de me dévouer – que je deviens Tout. Je ne suis rien que le mandataire de Dieu ou du Peuple, mais ce au nom de quoi je parle est tout, et à ce titre, je suis tout. […] C’est le droit de réprimande, de culpabilisation qui est un des profits du militant. »
(p271) le JE du mandataire est un NOUS, parfois usurpé.
Parfois, l’art dit populiste, qui souhaite valoriser le peuple comme un idéal de pureté ou de misère, l’art prolétarien, le réalisme socialiste… ce JE jdavonien, c’est-à-dire « petit bourgeois intellectuel de second ordre, qui veut faire régner l’ordre, surtout avec les intellectuels de premier ordre, et qui s’universalise en s’instituant en peuple. » (ex de JE usurpé).
« Ce sont des cas typiques de substitution de sujet. […] On se sert aujourd’hui du peuple, comme en d’autres temps on se servait de Dieu, pour régler des comptes entre clercs. » (p272)
Les délégués de l’appareil
Souvent le système consacre des gens sûrs, c’est-à-dire dont on est sûr qu’ils ne changeront pas le système. Ex de Staline, jugé médiocre, donc parfait. Par ailleurs, ils sont exaltés par la jeunesse qui, elle, si elle n’est pas médiocre, est en tout cas un regroupement de personnes qui n’a rien à perdre.
« Celui qui n’a rien est un inconditionnel ; il a d’autant moins à opposer que l’appareil lui donne beaucoup, à mesure de son inconditionnalité, et de son néant. » (p276)
Ces médiocres une fois au pouvoir ne réussissent que lorsqu’ils ne font rien, justement. Ils deviennent des professionnels de la manipulation, savent transformer les événements à leur avantage.
« […] il leur suffit de ne rien faire pour que les choses aillent dans le sens de leurs intérêts, et leur pouvoir réside souvent dans le choix, entropique, de ne pas faire, de ne pas choisir. » (p278)
- L’identité et la représentation
Par ex (p285) : « Le discours régionaliste est un discours performatif, visant à imposer comme légitime une nouvelle définition des frontières et à faire connaître et reconnaître la région ainsi délimitée contre la définition dominante et méconnue comme telle, donc reconnue et légitime, qui l’ignore. »
D’où l’importance de la dénomination !
Du coup, cela pose la question de ce qui existe vraiment. Et d’ailleurs, y a-t-il quelque chose qui existe vraiment ? Cette réalité des divisions par dénomination est subjective, devient objective ; comment l’étudier ?
« Saisir à la fois ce qui est institué, sans oublier qu’il s’agit seulement de la résultante, à un moment donné du temps, de la lutte pour faire exister ou « inexister » ce qui existe, et les représentations, énoncés performatifs qui prétendent à faire advenir ce qu’ils énoncent, restituer à la fois les structures objectives et le rapports à ces structures, à commencer par la prétention à les transformer, c’est se donner le moyen de rendre raison plus complètement de la « réalité », donc de comprendre et de prévoir plus exactement les potentialités qu’elle enferme ou, plus précisément, les chances qu’elle offre objectivement aux différentes prétentions subjectives. » (p288)
Les agents sociaux représentent les divisions de la réalité.
- Espace social et genèse des « classes »
L’espace social
Des classes sur le papier
La perception du monde social et la lutte politique
L’ordre symbolique et le pouvoir de nomination
Que fait le sociologue ? « il doit objectiver l’ambition d’objectiver, de classer du dehors, objectivement, des agents qui luttent pour classer et se classer. » (p312)
Or
« En réalité, l’espace social est un espace multidimensionnel, ensemble ouvert de champs relativement autonomes, c’est-à-dire plus ou moins fortement et directement subordonnés, dans leur fonctionnement et leurs transformations, au champ de production économique : à l’intérieur de chacun des sous-espaces, les occupants des positions dominantes et les occupants des positions dominées sont cesse engagés dans des luttes de différentes formes (sans nécessairement se constituer pour autant en groupes antagonistes).’ (314)
La classe comme représentation et volonté
La sociologie devrait interroger l’existence et le mode d’existence des collectifs.
(p323) « Le succès historique de la théorie marxiste, la première des théories sociales à prétention scientifique qui se soit aussi complètement réalisée dans le monde social, contribue ainsi à faire que la théorie du monde social la moins capable d’intégrer l’effet de théorie – qu’elle a plus qu’aucune autre exercé – représente sans doute aujourd’hui le plus puissant obstacle au progrès de la théorie adéquate du monde social auquel elle a, en d’autres temps, plus qu’aucune autre contribué. » (323)
POUR UNE PRAGMATIQUE SOCIOLOGIQUE :
TROIS ÉTUDES DE CAS
Introduction
La parole fait exister car elle implique le référent (c’est un postulat plus fort que celui du logicien Frege). Autrement dit, quand on dit La France, L’État, l’Opinion publique : on fait exister des référents, on les crée. Cela fonctionne d’autant mieux que les personnes qui nomment en ont l’autorité.
- La rhétorique de la scientificité : contribution d’une analyse de l’effet Montesquieu
Très bel exemple de ce que Bourdieu appelle « la cohérence mythique », notamment à partir des préjugés raciaux. Les hommes du nord, parce que dans le froid, sont plus vigoureux ; tandis que les hommes du sud sont moins travailleurs et plus enclins à la paresse. De même, les hommes sont du côté du nord et de la vigueur, tandis que les femmes sont du côté de la chaleur et de la mollesse. Pour finir l’exposé idéologique, un côté de l’humanité se trouve vouée à l’esclavage par nécessité de constitution ; l’autre est née pour être maître et c’est la nature qui le justifie. Cet exposé est fondé sur les couples d’opposés, ce que Bourdieu appelle « la cohérence mythique ».
« Mais partout, sous l’appareil scientifique, le socle mythique affleure. Et sans entrer dans une longue analyse, on peut restituer, sous la forme d’un schéma simple, le réseau d’opposition et d’équivalences mythiques, véritable structure fantasmatique qui soutient toute théorie. » (334)
« Ce serait donc rendre justice à l’auteur [Montesquieu] de l’Esprit des Lois que d’attribuer son nom à l’effet d’imposition symbolique tout à fait spécial que l’on produit en surimposant aux projections du fantasme social ou aux pré-constructions du préjugé, l’apparence de science qui s’obtient par le transfert des méthodes ou des opérations d’une science plus accomplie ou simplement plus prestigieuse. » (341)
- Censure et mise en forme
(343) » Les langues spéciales que les corps de spécialistes produisent et reproduisent par une altération systématique de la langue commune sont, comme tout discours le produit d’un compromis entre un intérêt expressif et une censure constituée par la structure même du champ dans lequel se produit et circule le discours. »
C’est un produit de stratégie d’euphémisation.
Cette censure structurale s’impose à tout producteur de biens symboliques.
Parmi les censures, il y a celle qui consiste à exclure certains agents de la communication.
En effet, les productions symboliques doivent leurs propriétés les plus spécifiques aux conditions sociales de leur production.
La forme imposée par le contexte répond à des normes connues et reconnues.
« La langue spéciale se distingue du langage scientifique en ce qu’elle recèle l’hétéronomie sous les apparences de l’autonomie : incapable de fonctionner dans l’assistance du langage ordinaire, elle doit produire l’illusion de l’indépendance par des stratégies de fausse coupure mettant en œuvre des procédés différents selon les champs et dans le même champ, selon les positions et selon les moments. » (347)
Les mots spécialisés sont les mêmes que ceux dits courants, mais il sont légèrement décalés et ce décalage est « destiné à marquer un écart allégorique » (349)
« La mise en forme produit, inséparablement, l’illusion de la systématicité et, à travers celle-ci et la coupure entre le langage spécialisé et le langage ordinaire qu’elle opère, l’illusion de l’autonomie du système. » (349)
Remarque : Les étudiants français semblent habitués ou éduqués aux formes d’expression alambiquées, appartenant à un autre monde (ainsi en jugent-ils en tout cas), qu’ils subissent avec violence. Ils semblent donc démunis devant la nécessité de s’exprimer simplement (sans ambiguïté, sans métaphore)
Bourdieu prétend que « l’imposition d’une coupure tranchée entre le savoir sacré et le savoir profane qui est constitutive de l’ambition de tout corps de spécialistes visant à s’assurer le monopole d’un savoir ou d’une pratique sacrée en constituant les autres comme profanes prend ainsi une forme originale. »
« La mise en forme qui tient le profane à distance respectueuse protège le texte contre la « trivialisation » en le vouant à une lecture interne, au double sens de lecture cantonnée dans les limites du texte lui-même et inséparablement réservée au groupe fermé des professionnels de la lecture. »


 Le scribe du souverain écrit sous sa dictée ou bien rédige lui-même après avoir écouté l’essentiel du message – certaines tablettes sont d’ailleurs des brouillons (164). Quoi qu’il en soit, on réfléchit pas mal AVANT d’écrire : Zimri-Lim demande ainsi à son ministre de le rejoindre pour rédiger une réponse à une lettre d’Hammu-rabi (au-dessus un exemple de petite tablette de traité : on y retrouve le serment que Zimri-Lin souhaitait que Hammu-rabi de Babylonie lui prête lors de la conclusion de leur alliance contre l’Elam)
Le scribe du souverain écrit sous sa dictée ou bien rédige lui-même après avoir écouté l’essentiel du message – certaines tablettes sont d’ailleurs des brouillons (164). Quoi qu’il en soit, on réfléchit pas mal AVANT d’écrire : Zimri-Lim demande ainsi à son ministre de le rejoindre pour rédiger une réponse à une lettre d’Hammu-rabi (au-dessus un exemple de petite tablette de traité : on y retrouve le serment que Zimri-Lin souhaitait que Hammu-rabi de Babylonie lui prête lors de la conclusion de leur alliance contre l’Elam)



 A gauche, L’adorant de Larsa, qui pourrait représenter Hammu-rabi. A droite, le code d’Hammu-rabi (environ 1750 avant JC)
A gauche, L’adorant de Larsa, qui pourrait représenter Hammu-rabi. A droite, le code d’Hammu-rabi (environ 1750 avant JC)
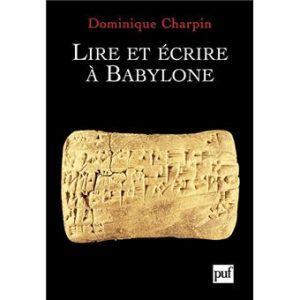 « Nous commencerons par poser la question de savoir si l’usage du cunéiforme était réservé à une petite caste de spécialistes, les scribes, comme on l’a longtemps pensé (Chap1). Puis nous présenterons les cadres et les méthodes de l’apprentissage de cette écriture (Chap2). On verra ensuite quels écrits étaient ainsi produits : il nous faudra d’abord examiner les documents d’archives (Chap3), en réservant un sort particulier, d’une part, aux textes juridiques (Chap4) et, d’autre part, à la correspondance (Chap5). Les bibliothèques constituent, à nos yeux, l’endroit par excellence de la lecture ; la situation se présentait de façon différente en Mésopotamie (Chap6). Rares étaient les textes écrits « pour l’éternité » : néanmoins, une partie de ceux qui nous sont parvenus étaient destinés aux divinités et à la postérité (Chap7). Lorsque le spécialiste lit une lettre, on peut considérer qu’il agit de manière indiscrète. En revanche, s’il déchiffre une inscription commémorative d’un souverain mésopotamien, il exauce le vœu de son commanditaire antique : faire que son nom ne tombe pas dans l’oubli… » (29)
« Nous commencerons par poser la question de savoir si l’usage du cunéiforme était réservé à une petite caste de spécialistes, les scribes, comme on l’a longtemps pensé (Chap1). Puis nous présenterons les cadres et les méthodes de l’apprentissage de cette écriture (Chap2). On verra ensuite quels écrits étaient ainsi produits : il nous faudra d’abord examiner les documents d’archives (Chap3), en réservant un sort particulier, d’une part, aux textes juridiques (Chap4) et, d’autre part, à la correspondance (Chap5). Les bibliothèques constituent, à nos yeux, l’endroit par excellence de la lecture ; la situation se présentait de façon différente en Mésopotamie (Chap6). Rares étaient les textes écrits « pour l’éternité » : néanmoins, une partie de ceux qui nous sont parvenus étaient destinés aux divinités et à la postérité (Chap7). Lorsque le spécialiste lit une lettre, on peut considérer qu’il agit de manière indiscrète. En revanche, s’il déchiffre une inscription commémorative d’un souverain mésopotamien, il exauce le vœu de son commanditaire antique : faire que son nom ne tombe pas dans l’oubli… » (29)


 (ci-dessous B&G) a pour principal objectif de dénoncer les dérives d’un domaine universitaire, à savoir la recherche en sociologie. A travers divers exemples, les auteurs critiquent notamment les modèles sociologiques de ceux qui passent aujourd’hui encore pour les incontournables maîtres en la matière, à savoir principalement Durkheim et Bourdieu (cf un article :
(ci-dessous B&G) a pour principal objectif de dénoncer les dérives d’un domaine universitaire, à savoir la recherche en sociologie. A travers divers exemples, les auteurs critiquent notamment les modèles sociologiques de ceux qui passent aujourd’hui encore pour les incontournables maîtres en la matière, à savoir principalement Durkheim et Bourdieu (cf un article :  – l’astrologie : la thèse d’Elisabeth Tessier soutenue en sociologie et défendant les vérités astrologiques ;
– l’astrologie : la thèse d’Elisabeth Tessier soutenue en sociologie et défendant les vérités astrologiques ;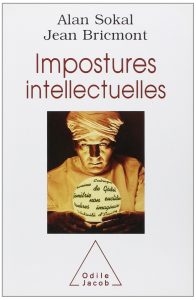

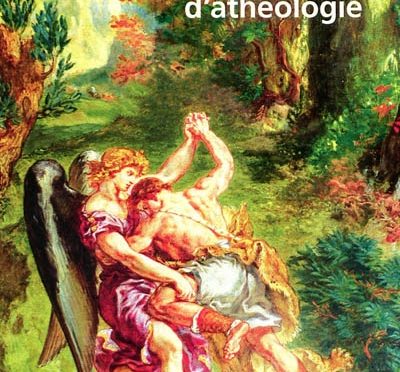
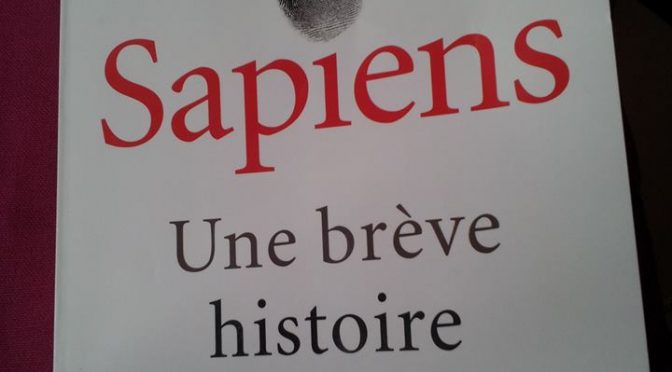





 Tenons-le pour dit par Diderot : si les femmes ont contribué à rendre pérenne la religion, c’est contraintes par un despotisme masculin tyrannique. Pour parfaire le tableau, il rapporte le récit d’une femme indienne d’Amazonie, réduite en esclavage auprès de son époux et qui conclut :
Tenons-le pour dit par Diderot : si les femmes ont contribué à rendre pérenne la religion, c’est contraintes par un despotisme masculin tyrannique. Pour parfaire le tableau, il rapporte le récit d’une femme indienne d’Amazonie, réduite en esclavage auprès de son époux et qui conclut :